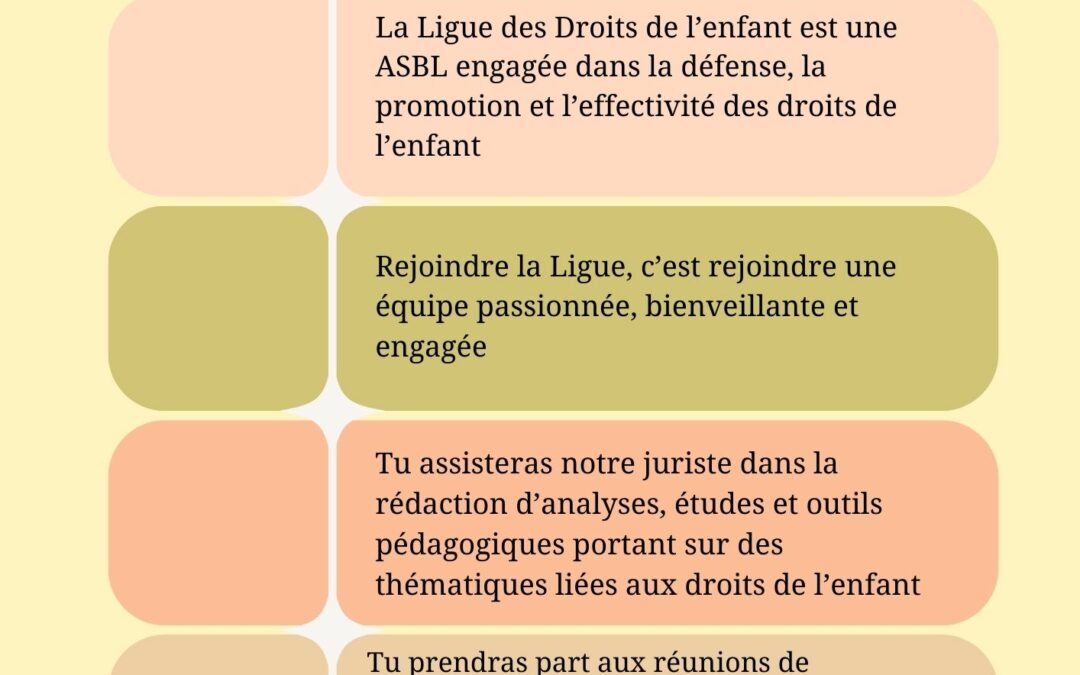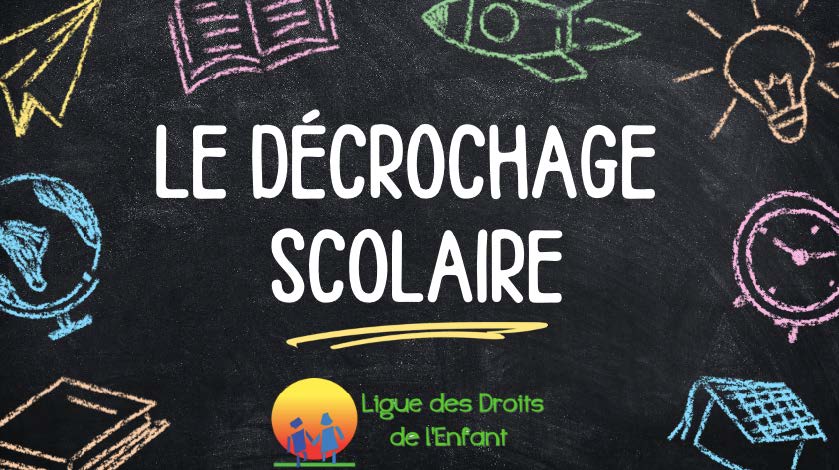
Comprendre les facteurs du décrochage scolaire
Comprendre les facteurs du décrochage scolaire
Le décrochage scolaire constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour les systèmes éducatifs européens, et la Belgique n’échappe pas à cette réalité.
Dans un contexte marqué par les transformations sociales, économiques et culturelles, l’école se voit investie d’une mission centrale. Celle d’assurer l’égalité des chances et favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Pourtant, malgré l’obligation scolaire et les nombreuses politiques de soutien mises en place, une partie des élèves quitte prématurément le système éducatif sans diplôme ou qualification reconnue. Ce phénomène, souvent qualifié d’abandon scolaire précoce, ne se résume pas à un simple acte individuel. En effet, il s’inscrit dans un processus progressif de désengagement qui s’installe au fil du temps.
Des causes multifactorielles
Le décrochage scolaire ne peut être compris sans tenir compte de son caractère multifactoriel. Les causes sont à la fois individuelles, familiales, scolaires et sociales.
Certaines difficultés d’apprentissage non prises en charge, un sentiment d’échec répété, une orientation subie ou mal comprise peuvent progressivement fragiliser le lien entre l’élève et l’institution scolaire.
À cela s’ajoutent des facteurs familiaux tels que la précarité économique, le manque de soutien éducatif ou des contextes de vie instables.
Par ailleurs, le système scolaire belge, souvent décrit comme l’un des plus inégalitaires d’Europe en termes de reproduction des inégalités sociales, tend à renforcer les écarts entre élèves issus de milieux favorisés et défavorisés. Les mécanismes de relégation, notamment à travers certaines filières, peuvent contribuer à alimenter un sentiment de stigmatisation et de démotivation.
Un phénomène complexe
Ainsi, le décrochage scolaire en Belgique apparaît comme un phénomène complexe, ancré dans des dynamiques à la fois individuelles et structurelles.
Comprendre ses causes constitue une étape essentielle pour élaborer des stratégies efficaces de prévention et garantir à chaque jeune un parcours scolaire porteur de sens et d’opportunités.
Différents profils de jeunes à risques
Les profils de jeunes à risque montrent d’ailleurs la diversité des situations : certains expriment leur mal-être par la contestation et le conflit, d’autres se replient dans le silence et le désengagement, tandis que d’autres encore sont confrontés à des difficultés familiales, socio-économiques ou psychologiques lourdes.
Les facteurs scolaires, tels que les échecs répétés, l’étiquetage, un climat de classe négatif ou encore le harcèlement, peuvent accentuer le sentiment de ne pas être à sa place.
À cela s’ajoutent des fragilités personnelles, notamment en matière de santé mentale, particulièrement marquées depuis la crise du Covid-19 et dans un contexte global d’incertitude sociale, climatique et économique.
Les inégalités socio-économiques, mises en évidence notamment par les enquêtes internationales comme PISA, rappellent que tous les jeunes ne disposent pas des mêmes ressources pour faire face aux exigences scolaires. Ainsi, le décrochage scolaire constitue également un révélateur d’inégalités structurelles.
La Ligue des Droits de l’Enfant a eu l’honneur et le plaisir de participer, en janvier, à une matinée thématique organisée par le CPAS d’Etterbeek, consacrée au décrochage scolaire. Cet événement nous a offert l’occasion d’échanger avec divers professionnels sur ce phénomène qui touche de nombreux jeunes.
Lors de notre intervention, il nous a semblé essentiel d’analyser les causes et facteurs à l’origine du décrochage, d’en mesurer les conséquences, et surtout d’explorer les pistes susceptibles de diminuer ce phénomène. Cet outil pédagogique s’appuie sur cette présentation.