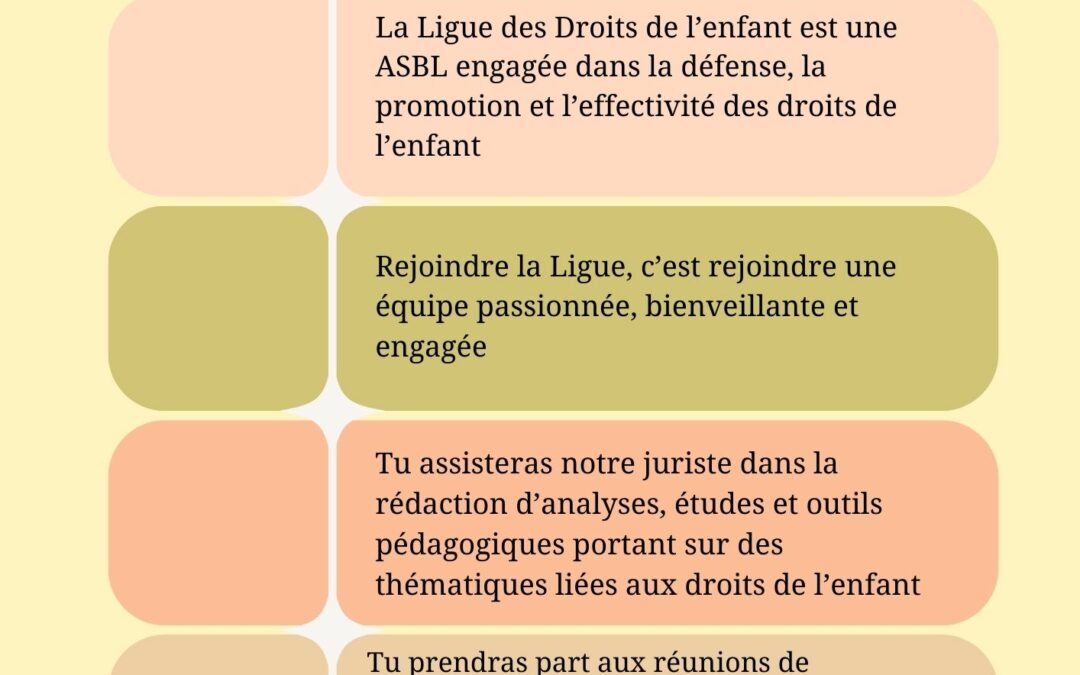Nouvelle analyse
L’inceste, se définit comme étant « toute relation sexuelle entre deux ou plusieurs membres d’une même famille » [1]. Les actes sexuels sont commis entre membres d’une même famille ou entre personnes liées par un lien familial, de parenté ou une relation d’autorité similaire [2].
L’inceste demeure un sujet profondément tabou dans la société belge, comme ailleurs. Malgré sa gravité et ses lourdes conséquences psychologiques pour les victimes, il reste souvent enfoui dans le silence familial et social.
En Belgique, les cas d’inceste sont difficilement quantifiables, en raison d’une forte sous-déclaration. Parce qu’il demeure tabou, ce silence, souvent entretenu par la peur, la honte, la culpabilité ou encore le déni familial, rend l’identification et la prise en charge des victimes extrêmement complexes. Pourtant, les conséquences de ces violences sont profondes et durables, notamment lorsqu’elles touchent des enfants : troubles psychologiques, traumatismes, perte de repères, difficultés relationnelles, voire altérations majeures du développement émotionnel.
Au-delà de l’atteinte individuelle subie par l’enfant, l’inceste constitue une violation grave de ses droits fondamentaux. En ratifiant la Convention internationale des droits de l’enfant en 1991, la Belgique s’est engagée à garantir à chaque enfant la protection, le respect et la réalisation de ses droits. Or, l’inceste bafoue de manière directe plusieurs articles de cette convention. L’article 19 stipule que les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, y compris les abus sexuels, qu’ils soient exercés par des parents ou toute autre personne ayant autorité sur lui. L’article 34 quant à lui renforce cette obligation en imposant aux États de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelle. Ces dispositions ne sont pas symboliques. Celles-ci impliquent des devoirs concrets, tant en matière de prévention que de protection des enfants et de leurs droits [3].
Que fait la Belgique ?
Néanmoins, malgré ces engagements, la Belgique peine encore à faire de la lutte contre l’inceste une priorité claire et systémique. Longtemps ignoré ou mal nommé dans le droit belge, l’inceste n’a été reconnu explicitement qu’avec l’adoption du nouveau Code pénal sexuel, entré en vigueur en 2022. Ce progrès législatif marque une avancée importante, mais il ne résout pas à lui seul les nombreux obstacles que rencontrent les victimes pour dénoncer les faits et obtenir réparation.
Le climat de silence qui entoure l’inceste, combiné à la dépendance affective et matérielle vis-à-vis de l’agresseur, rend souvent la parole de l’enfant extrêmement difficile, voire impossible. Or, selon l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, ce dernier a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question le concernant, et de voir ses propos pris en considération avec sérieux et respect, en fonction de son âge et de sa maturité.
Que faire ?
Dans ce contexte, la lutte contre l’inceste ne peut se limiter à un cadre juridique. Cette prise en compte nécessite une approche globale, incluant la sensibilisation du public, la formation des professionnels, la création de lieux d’écoute sécurisés pour les enfants, et le développement de structures spécialisées dont l’objectif est l’accompagnement des victimes sur le long terme. Il est également primordial de garantir un accès effectif à la justice, avec des procédures adaptées aux enfants, évitant la double victimisation et favorisant leur reconstruction.
En définitive, protéger les enfants contre l’inceste, c’est faire respecter leurs droits les plus fondamentaux, au cœur même de la cellule familiale, là où ils devraient être les plus en sécurité, raison pour laquelle ce combat semble essentiel pour la Ligue des Droits de l’Enfant. Cette nouvelle analyse prend la forme de vrai ou faux dont les dix préjugés sont listés ci-dessous, afin de permettre d’explorer un thème sensible tout en facilitant sa compréhension.
Vrai ou faux ?
- L’inceste est un synonyme de violences sexuelles
- La notion de « famille » se rapporte seulement aux parents
- La Convention internationale relative aux droits de l’enfant protège les enfants contre l’inceste
- L’inceste n’est pas puni par la loi
- Le nombre de cas d’enfants victimes d’inceste en Belgique est actuellement beaucoup plus élevé qu’auparavant
- L’inceste laisse des séquelles psychologiques
- Il est facile de déceler les situations d’inceste
- L’EVRAS permet de prévenir l’inceste
- La parole de l’enfant n’a pas beaucoup d’importance
- Il n’existe pas de lieu de prise en charge en Belgique pour les enfants victime d’inceste et de violences sexuelles