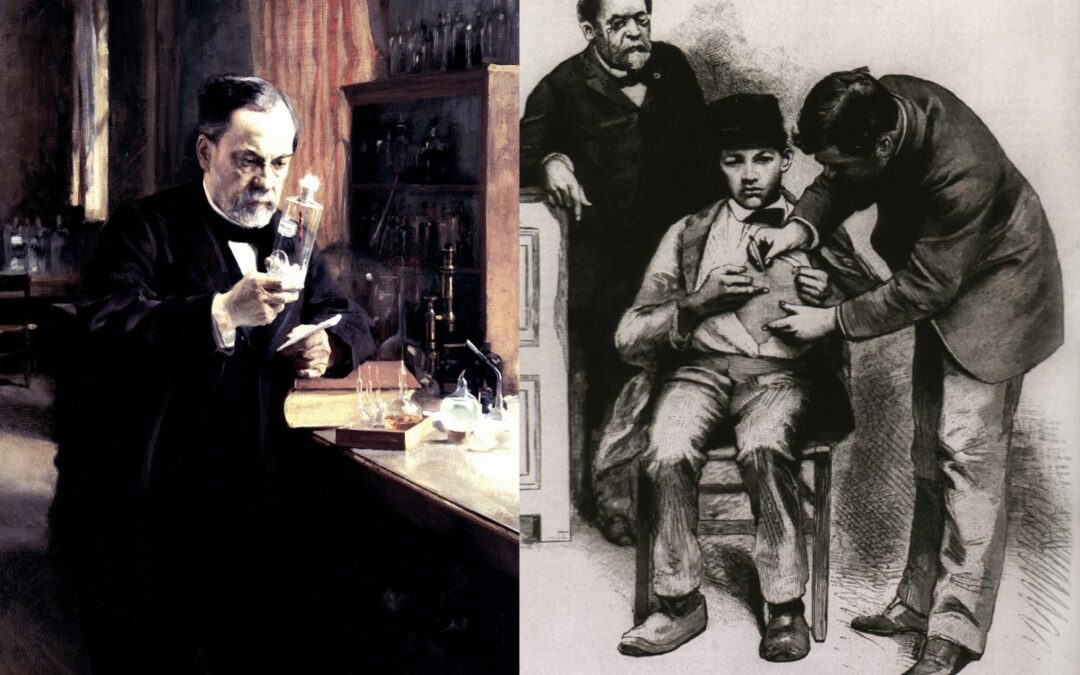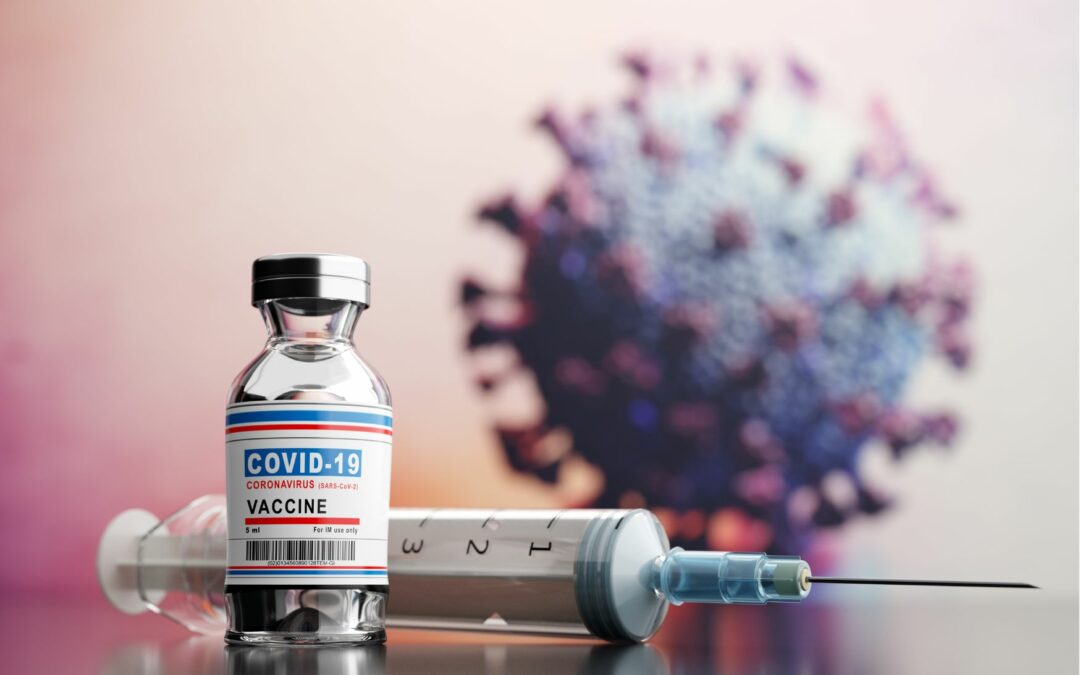Avr 14, 2021 | Ecole - Education - Inclusion, Participation - Liberté - Expression
Fin d’année scolaire 2020-2021
Nous appelons à la mise en place de procédures strictes
Les membres de la plate-forme de lutte contre l’échec scolaire, soutenus par d’autres associations de la société civile, appellent le Gouvernement et les Pouvoirs organisateurs à baliser strictement la fin de cette année scolaire.
Les élèves, les étudiants, les enseignants mais aussi les familles sont largement éprouvés par la pandémie et les mesures Covid qui sont prises dans les écoles. Les inégalités se creusent fortement et le nombre de personnes vivant la pauvreté s’accroit. Les enfants sont touchés. On ne compte plus les jeunes en décrochage, que ce soit de manière visible mais aussi et surtout invisible. Aux deuxième et troisième degrés du secondaire, l’enseignement hybride a montré ses limites et précarisé plus encore les élèves ayant des difficultés, ainsi que les familles non équipées ou peu habituées à utiliser l’informatique. De nombreux adolescents et jeunes adultes ont décroché. Ils ne sont pas responsables de cette situation, pas plus que les enseignants. Il y a donc lieu de soulager tout le monde en modifiant les habituelles traditions de fin d’année que sont les sessions d’examens et les échecs qu’elles entraînent.
La notion de bienveillance et le caractère « exceptionnel » n’étant pas objectivables, il convient de se prémunir des interprétations subjectives que l’on a pu connaître l’an dernier. Ainsi, devant la situation de santé psychologique des adolescents, nous demandons qu’un cadre légal spécifique à cette fin d’année soit créé. Celui-ci comprendra les balises et procédures à respecter impérativement et donnera aux équipes éducatives le moyen de se les approprier.
Dès lors, nous appelons à fixer des procédures précises pour le dernier trimestre 2020-2021
- Le temps et la forme des évaluations de fin d’année
Hormis pour les années certificatives (CEB, CE1D, CESS et années diplômantes du qualifiant), nous appelons à ce que l’évaluation de l’état d’acquisition des essentiels ne passe pas par des examens de fin d’année. Cela ne doit pas empêcher des évaluations diagnostiques qui permettent de soutenir les décisions des conseils de classe, en mettant en évidence les difficultés des élèves, et ainsi de planifier l’année prochaine. Ces difficultés seront, évidemment, communiquées aux enseignants de l’année suivante.
Le temps gagné dans les années non certificatives par la suppression des examens devra être réinjecté, en tout ou en partie, dans du temps de travail pour les enseignants afin de mener ce processus évaluatif en collaboration avec l’élève et sa famille.
Afin de permettre aux enseignants et aux élèves de planifier le troisième trimestre, nous proposons que les enseignants réalisent individuellement avec chaque élève un diagnostic, afin d’évaluer ensemble l’état d’acquisition des essentiels, dans un dialogue constructif et pluriel. Ce diagnostic sera ensuite communiqué à l’élève et à ses parents.
Une fois ce diagnostic réalisé, nous demandons que des actions pédagogiques soient mises en place dans les écoles afin de permettre aux élèves de remédier aux lacunes, sans que cela porte préjudice aux activités liées au bien-être et entraîne une surcharge de travail à domicile.
Le diagnostic peut, à la demande de l’élève, se faire avec un tiers associatif ou de l’école (CPMS, professeur choisi, SAS, AMO, …) qui sera également présent lors du conseil de classe, afin d’étudier les pistes pour la suite, en fonction de la réalité d’aujourd’hui.
Nous demandons qu’une attention toute particulière soit portée aux élèves issus de familles socialement défavorisées, qui ont vécu cette période à distance ou en hybridation, dans un contexte particulièrement inégalitaire (matériel, connexion, espace de vie) ainsi qu’à ceux qui sont les plus éloignés des codes scolaires. De même, il est essentiel de renouer le lien avec les jeunes qui ont décroché, notamment, en prenant contact avec les acteurs autour de l’école qui ont pour mission d’aider au lien école-familles (CPMS, AMO , Services communaux de prévention du décrochage scolaire, etc.), sans oublier les jeunes qui ne sont plus en âge d’obligation scolaire mais qui étaient inscrits à l’école en septembre 2020.
Il est indispensable qu’il y ait une approche proactive diversifiée de la part de tous les acteurs concernés (école, CPMS, éducateurs, services d’accrochage, …) afin que des démarches concrètes se fassent pour « aller vers les parents , vers les jeunes », par tous les moyens disponibles (contacts téléphoniques, courriers postaux, visite au domicile, …), en tenant compte des difficultés rencontrées par les familles liées à la langue, à l’écrit ou encore à l’informatique.
Un dialogue sera mené avec les parents afin de leur communiquer les pistes identifiées par le diagnostic et les actions pédagogiques qui sont mises en place. Un tiers associatif pourra être présent à la demande des familles, ainsi qu’un traducteur si cela s’avère nécessaire. Les résultats du diagnostic et les mesures prises seront présentés aux parents en communiquant de manière adaptée (oralement, en fixant un rendez-vous à l’école, avec l’aide de traducteurs si nécessaire).
Dans le cas où le diagnostic concerne des élèves en fin de parcours, l’élève reste en droit de connaître son niveau d’acquisition, ou pas, des essentiels attendus. A cet égard, des actions pédagogiques devront également être mises en place pour les élèves poursuivant des études supérieures[1] ou pour ceux qui se rendraient disponibles sur le marché du travail[2].
Les décisions du conseil de classe doivent être prises à la suite d’un dialogue en amont avec les parents et les élèves :
Circulaire 7594 (p. 16) : « Vu le contexte anxiogène actuel, il est important que la décision du Conseil de classe soit prise en dialogue avec les parents et les élèves, afin que la décision prise puisse être comprise et vécue de manière positive par l’élève et ses parents »
Pour les élèves pour lesquels la décision pourrait être un examen de passage ou un redoublement, le dialogue préalable avec les parents doit être obligatoire. Si la décision est l’examen de passage ou le redoublement et qu’un dialogue n’a pas été planifié avant le conseil de classe, alors le dialogue doit être obligatoire a postériori et une révision éventuelle de la décision par le conseil de classe doit être rendue possible (recours interne après conseil de classe : faciliter cette procédure).
Les motivations des décisions prises par le conseil de classe doivent être détaillées par la communication des essentiels vus en classe, le diagnostic communiqué, le dialogue entamé et notifié et la proposition d’accompagnement personnalisé pour l’année suivante.
Toute invitation au dialogue comportera toujours une notification, de manière explicite, à faire signer par les parents afin qu’ils puissent dire s’ils souhaitent se faire accompagner par un tiers associatif et/ou un traducteur.
Le redoublement doit être exceptionnel.
Toute décision de redoublement ou d’orientation doit être prise en dialogue avec les parents et les élèves. Elle doit être impérativement motivée pédagogiquement et basée sur des épreuves diagnostiques exclusivement basées sur les essentiels, et non sur des interros faites entre les apprentissages à distance. Un plan personnalisé pour l’année suivante sera élaboré avec l’élève, qui tiendra compte de ses acquis et de ses lacunes (cours entiers, unités d’apprentissage au sein d’un cours, savoir, savoir-faire, compétences) et servira de tableau de bord des apprentissages durant l’année suivante.
- Examens de passage (ajournements)
Les examens de passage devraient être interdits, sauf éventuellement dans les années certificatives.
Toute décision d’examen de passage doit être prise en dialogue avec les parents et les élèves, et éclairée par le diagnostic et sur base d’épreuves diagnostiques exclusivement basées sur les essentiels.
En cas d’absence de diagnostic, cela doit être notifié par écrit aux parents ou à l’élève majeur, de manière à permettre un recours éventuel.
Dans l’hypothèse où le dialogue n’aurait pas eu lieu avant les évaluations diagnostiques ou externes, et afin d’examiner collégialement les motivations de la décision prise, l’école organisera obligatoirement une réunion à distance ou en présentiel pour les familles et les élèves qui le demandent, avec présence autorisée d’un tiers. L’objectif est de permettre aux parents qui le désirent, ou qui sont en difficulté avec l’écrit, d’introduire leur demande de cette manière.
En cas de refus de mettre en place ce dialogue, il y aura lieu de le notifier par écrit, afin de permettre aux familles et aux élèves majeurs, de joindre cette notification pour justifier la recevabilité de leur recours externe.
Les écoles communiqueront aux parents et aux élèves les coordonnées des associations susceptibles de les aider dans leur démarche de recours.
Nous demandons
- que les « Essentiels et balises » soient explicitement identifiés dans un texte faisant force de loi ;
- que les chambres de recours fondent leurs décisions en se référant aux « Essentiels et balises » identifiés par le régulateur (et inscrits dans un décret) et sur les essentiels identifiés comme vus par les équipes éducatives ;
- et qu’elles considèrent obligatoirement les arguments présentés par les parents et les élèves majeurs portant sur les procédures exceptionnelles COVID adoptées et explicitées dans les circulaires, et que ces éléments recevables pour l’examen d’un recours externe soient communiqués clairement aux parents et aux élèves majeurs :
- la communication des essentiels vus en classe,
- le diagnostic communiqué,
- le dialogue entamé et notifié,
- la proposition d’accompagnement personnalisé pour l’année suivante, en dialogue avec les parents et les élèves.
Signataires :
Michèle Janss pour l’APED (Appel Pour une Ecole Démocratique)
Arnaud Groessens, pour ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles
Jean-Charles Wiart et Logan Verhoeven, pour Le CEF (Comité des élèves francophones)
Geoffrey Carly,pour les CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active)
Annick Faniel, pour le CERE asbl (Centre d’expertise et de ressources pour l’Enfance)
Fred Mawet, pour CGé (ChanGements pour l’égalité)
Le comité de pilotage de la Coalition des parents de milieux populaires et des organisations qui les soutiennent
Alain Moriau, pour l’ASBL Compas Format, Service d’Accrochage Scolaire
Véronique De Thier, Joëlle Lacroix, pour la FAPEO (Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel)
Marie-Hélène André et Stéphanie Demoulin, pour la FFEDD (Fédération Francophone des Ecoles de Devoirs)
François Deblander, pour Infor-Jeunes Bruxelles
Chantal Massaer, pour Infor-Jeunes Laeken
Jean-Pierre Coenen, pour la Ligue des Droits de l’Enfant
Christophe Cocu et Maxime Michiels, pour la Ligue des Familles
Cécilia Locmant et Sylvie Pinchart, pour Lire et Ecrire
Anne-Françoise Janssen et Christine Mahy, pour le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
Quentin Derriks, pour le Sas Brabant wallon
Jean Queriat, pour l’ASBL SENS-SAS, Service d’Accrochage Scolaire
Fatima Zaitouni, Marco Giannoni, pour SOS Jeunes – Quartier Libre AMO
Bernard Hubien, pour l’UFAPEC (Union Francophone des Associations de Parents de l’Enseignement Catholique)
Manuel Fayt, pour le SEL-SETCA
Joseph Thonon, pour la CGSP-enseignement
[1] Avec les universités, hautes écoles ou écoles supérieures des arts.
[2] Avec le Forem et Actiris
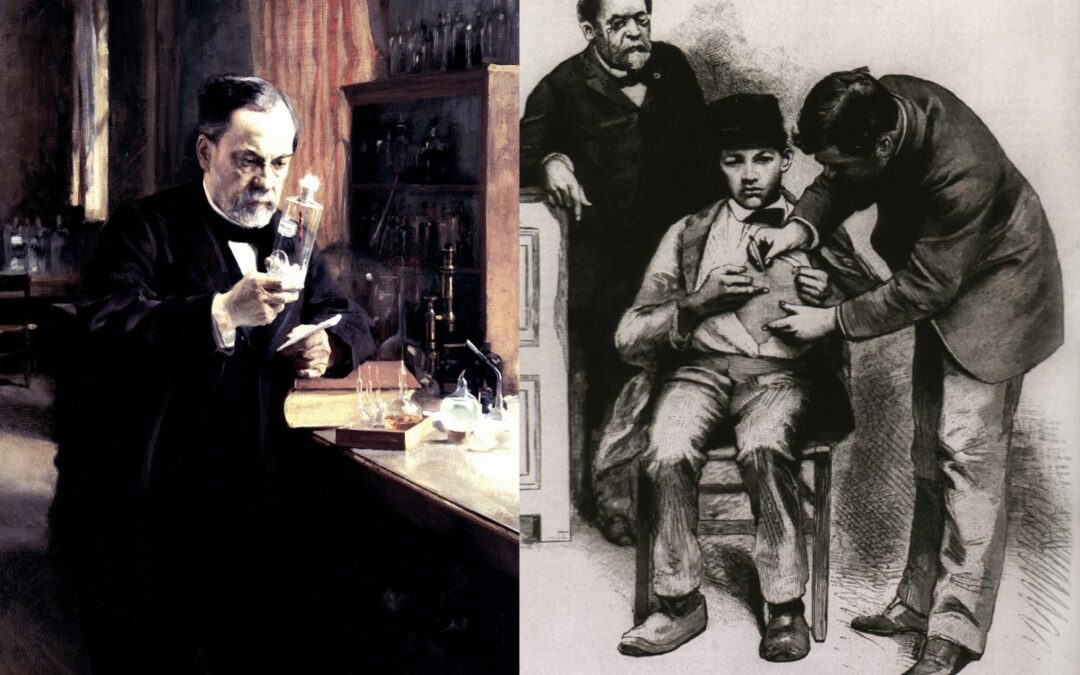
Fév 6, 2021 | Environnement - Santé - Alimentation
Depuis des siècles, l’Homme a combattu les maladies infectieuses sous des formes diverses : exclusion des lépreux au Moyen-âge, chassés des villes ou placés dans des léproseries. On plaçait également en en quarantaine[1] les passagers qui venaient d’un port où régnait la peste. Ceux-ci étaient enfermés pendant 40 jours dans un lazaret[2].
Depuis des millénaires, les Hommes ont compris que certaines maladies, comme la peste, ne se contractaient jamais deux fois. Les personnes qui en avaient réchappé pouvaient s’approcher des malades sans crainte et les soigner.
A partir du XVIIIe siècle en Europe, pour les prémunir de la variole[3] (appelée aussi petite vérole), on mit des enfants sains en présence d’individus contagieux, afin qu’ils soient immunisés. Comme pour d’autres maladies, les sujets qui en avaient réchappé ne risquaient plus de récidives. On leur inoculait le pus d’une pustule fraîche par scarification[4]. C’était la variolisation naturelle, prélude à la variolisation artificielle. Cette première technique[5], qui n’était pas sans dangers, prétendait protéger les enfants d’une variole grave.
A la fin du XVIIIe siècle, Edward Jenner, médecin anglais qui pratiquait couramment l’inoculation de la variole découvrit que les vachères qui avaient été atteintes de vaccine (appelée aussi variole de la vache – Vacca) ne contractaient jamais la variole. La vaccine se manifestait sous la forme de pustules sur leurs mains. Le 14 mai 1796, Jenner transféra un peu de pus prélevé dans une de ces pustules au fils d’un de ses employé. James Phipps avait 8 ans et n’avait jamais contracté la variole.
L’enfant développa quelques symptômes peu graves (augmentation de quelques ganglions, un peu de fièvre, mal de tête, courbature et manque d’appétit. Il retrouva vite la santé. Jenner inocula ensuite la variole au jeune Phipps, puis, plus tard à la fermière. Dans les deux cas, la variolisation ne prit pas. Ils étaient immunisés. Ainsi la vaccine, maladie anodine des vaches, protégeait l’Homme contre une maladie mortelle, la variole.
Jenner publia un ouvrage à compte d’auteur, qui fut rapidement traduit dans plusieurs langues. La technique était complexe : on inoculait le pus prélevé sur le pis d’une vache à un premier individu. Ensuite, lorsque celui-ci voyait apparaître ses premières pustules, on en prélevait le pus qu’on transmettait à un second individu et ainsi de suite. C’est ainsi qu’est née la vaccination bras à bras. Evidemment, cela nécessitait d’avoir toujours un réservoir de pustules fraîches sous la main. On utilisa alors les enfants de orphelinats qu’on vaccinait par roulements, afin de garantir le stock de pustules[6]. En effet, la préservation de la vaccine in vitro présentait des difficultés techniques.
Les pays qui pratiquèrent la vaccination virent la mortalité pour cause de variole chuter de 10% à 1% en seulement quelques années. Pourtant, la vaccination de bras à bras n’était pas sans danger, entraînant d’autres contaminations comme la syphilis et les hépatites.
Certains pays pratiquaient des rappels systématiques à l’âge adulte, tandis que d’autres non. Dans ces derniers des épidémies réapparurent qui firent des centaines de milliers de morts[7].
La variole ne disparut de la plupart des régions du globe que dans les années 1950, mais ce n‘est qu’en 1980 que l’OMS déclara officiellement qu’elle était la première maladie à avoir été combattue par des actions concertées et ciblées à l’échelle mondiale[8].
Mais la vaccination de Jenner ne protégeait que contre la variole. Pour d’autres maladies graves, on continuait à pratiquer l’inoculation. Celle-ci avait de fâcheux inconvénients : un taux de mortalité conséquent et la contagiosité des patients traités durant les premiers temps.
C’est Pasteur qui, en 1879, découvrit le premier vaccin atténué artificiellement. Il ne s’agissait plus d’une souche proche de celle qui provoque la maladie, mais de virus de la même souche que la maladie, affaiblis.
Pasteur, qui travaillait alors sur le choléra des poules, retrouva de vieilles cultures de cette bactérie qu’il administra à ces poules. Celles-ci tombèrent malades mais n’en moururent pas. Même en les infectant avec des germes frais et virulents. Il comprit que le changement de virulence provenait de l’exposition de ces cultures à l’oxygène de l’air. Il énonça alors le principe de la vaccination comme étant « des virus affaiblis ayant le caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle. »
Après s’être attelé à produire un vaccin atténué contre le charbon des moutons, Pasteur décida d’adapter la vaccination à l’Homme. Il fixa sa priorité sur une maladie qui touche à la fois l’Homme et les animaux : la rage. A partir de cerveaux d’animaux morts de la rage, il réussit à en cultiver des germes et à en atténuer la virulence. Après deux semaines, le virus n’était plus mortel pour les chiens.
C’est le 4 juillet 1884 que Pasteur l’administra avec succès sur un jeune berger mordu par un chien enragé, Joseph Meister. Mais ce ne sera qu’en 1931 que Joseph Lennox Pawan réussit à mettre en évidence le virus responsable de cette maladie.
Au début du XXe siècle la lutte contre la tuberculose fit un bond en avant avec la mise au point de plusieurs vaccins contre le bacille de Koch[9], le « bovo vaccin » préparé en 1902 par Behring et le « Tauruman » préparé par Robert Koch. Ces deux vaccins ne prouvèrent pas leur efficacité sur le long terme. Ce ne sera qu’en 1921 que Calmette et Guérin parviendront à mettre au point un autre vaccin : le BCG[10]. A la fin d’essais cliniques entre 1924 et 1926, il avait montré une efficacité de 93% contre a tuberculose mortelle chez le jeune enfant[11]. C’est encore aujourd’hui le vaccin le plus administré au monde[12]. Mais il sera sans doute bientôt dépassé dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.
Les progrès de la vaccination continueront tout au long du XXe siècle. Le vaccin contre la diphtérie et le tétanos apparut dans les années 1920[13], comme celui contre typhoïde. Dans les années 1930, ce fut le vaccin contre la fièvre jaune. Dans les années 40, Jonas Salk met au point le premier vaccin contre la grippe afin de pouvoir vacciner le corps expéditionnaire américain en Europe. Vingt ans plus tard, le premier vaccin injectable contre la poliomyélite. Toujours dans les années 50-60, les vaccins à plusieurs valences (vaccins combinés) indiqués dans la prévention de pathologies conjointes comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, ainsi que des infections invasives à Haemophilus influenzae type b telles les méningites, les septicémies, les cellulites, les arthrites, les épiglottites, etc.
Après les années 1960 la mise au point de vaccins contre les pneumocoques, les méningocoques A et C ainsi que celui contre le papillomavirus humain (2006), se sont ajoutés à la longue liste.
Aujourd’hui, c’est le génie génétique qui s’appuient sur l’ADN recombinant[14]. On insère un gène d’un virus dans une cellule (de levure, d’animal…) pour produire un antigène. Ce procédé permet le développement du vaccin contre l’hépatite B, au début des années 80[15].
[1] Le premier Etat à imposer la quarantaine afin de protéger son commerce fut la république de Venise en 1423.
[2] Etablissement dont le nom vient de la parabole de Lazare, personnage d’un pauvre et d’un riche dans l’évangile selon Luc.
[3] Il est vraisemblable que la variole soit une zoonose (maladie infectieuse qui se transmet naturellement de l’animal à l’homme) probablement apparue en Afrique et en Chine environ dix mille ans avant JC.
[4] Wikipédia : La scarification est une pratique consistant à effectuer une incision superficielle de la peau humaine.
[5] Cette technique aux résultats aléatoires fut abandonnée après la découverte de la vaccination.
[6] MOULIN Anne-Marie. Aventure de la vaccination. La Flèche : Fayard, 1996 (Coll. Penser la médecine).
[7] En France, la reprise de l’épidémie fit près de 200 000 morts de 1870 à 1871, dont 23 000 soldats français contre moins de 500 côté allemand.
[8] OMS, Programme d’éradication de la variole (1966-1980), Mai 2010
[9] Du nom de l’allemand Robert Koch, qui l’a découvert en 1882.
[10] BCG = vaccin Bilié de Calmette et Guérin, du nom de ses inventeurs.
[11] Calmette A, Guérin C, Nègre L, Boquet A. Prémunition des nouveau-nés contre la tuberculose par le vaccin BCG (1921 à 1926). Ann Inst Pasteur 1926 ; 40 : 89–133.
[12]https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2016/07/medsci20163206p535/medsci20163206p535.html
[13] https://www.vaccination-info.be/histoire-de-la-vaccination/
[14] Futura Santé : L’ADN recombinant est le terme médical utilisé pour décrire l’épissage des gènes; consistant à prendre le gène d’un individu et à l’introduire dans le génome d’une autre personne.
[15] https://www.vaccination-info.be/histoire-de-la-vaccination/

Fév 6, 2021 | Environnement - Santé - Alimentation
Sur le plan scientifique, le vaccin est défini en ces termes :
Les vaccins pour usage humain sont des préparations contenant des antigènes[1] ayant la propriété de créer chez l’homme une immunité[2] active spécifique contre l’agent infectant ou la toxine, ou l’antigène élaboré par celui-ci. Les réponses immunitaires comprennent l’induction des mécanismes innés et adaptifs (cellulaires, humoraux) du système immunitaire. Il doit être démontré que les vaccins à usage humain possèdent une activité immunogène[3] et une innocuité[4] acceptables chez l’homme lorsqu’ils sont administrés selon le programme de vaccination préconisé.
Les vaccins pour usage humain peuvent être constitués par :
- des microorganismes entiers (bactéries, virus ou parasites), inactivés par des moyens physiques ou chimiques qui maintiennent des propriétés immunogènes[5] adéquates ;
- des microorganismes vivants entiers naturellement avirulents[6] ou qui ont été traités afin d’atténuer leur virulence tout en maintenant des propriétés immunogènes adéquates ;
- des antigènes extraits des microorganismes ou sécrétés par des microorganismes ou préparés par génie génétique ou synthèse chimique.
Les antigènes peuvent être utilisés dans leur état d’origine où ils peuvent être détoxifiés par des moyens physiques ou chimiques et peuvent être sous forme d’agrégats[7], de conjugats[8] ou de polymères[9] afin d’augmenter leur pouvoir immunogène.
Les vaccins peuvent contenir un adjuvant[10]. Si l’antigène est adsorbé sur un adjuvant minéral, le vaccin est appelé vaccin adsorbé[11].
Si cette définition scientifique est du chinois pour l’immense majorité d’entre nous, il est possible de trouver sur Internet des définitions plus compréhensibles, afin d’expliquer ce qu’est un vaccin à nos enfants, telle celle-ci : Un vaccin est un produit médical qu’on introduit dans le corps pour le protéger à l’avance d’une maladie. Il n’existe pas de vaccin universel. Chaque vaccin correspond à une maladie précise. Il s’agit en effet d’une forme atténuée de la bactérie ou du virus responsable de cette maladie. Selon les cas, le vaccin s’avale (anti-poliomyélite), est inoculé par piqûre (anti-dyphtérique) ou par une petite coupure sur la peau (anti-variolique).
Sans rendre malade, le vaccin provoque dans l’organisme (une réaction) la fabrication d’anticorps qui aideront par la suite à combattre la maladie. On appelle cette protection l’immunité. Selon les maladies, l’immunité est définitive ou temporaire (ce qui est le cas du tétanos, pour lequel il faut faire régulièrement des piqûres de rappel).
Pour la grippe, comme les virus ont des origines très diverses, on propose chaque année un nouveau vaccin, notamment pour les personnes fragiles pour lesquelles la maladie pourrait avoir de graves conséquences[12].
Le terme de « vaccination » a été introduit en 1800 par un chirurgien anglais, Richard Dunning dans son opuscule Some observations on vaccination[13].
[1] Futura-sciences, définitions : On appelle antigène toute substance étrangère à l’organisme capable de déclencher une réponse immunitaire visant à l’éliminer.
[2] Futura-sciences, définitions : L’immunité désigne la capacité de l’organisme à se défendre contre des substances étrangères, comme des agents infectieux. Elle se manifeste grâce à la réaction immunitaire.
[3] Universalis : qui produit l’immunité, faculté d’un organisme à ne pas devenir malade face à un agent pathogène (poison, toxine, microbe)
[4] Larousse : qui n’est pas toxique, nocif
[5] Larousse : Qui induit une réaction immunitaire.
[6] Larousse : Se dit d’un micro-organisme qui, chez un hôte ou dans un milieu donné, possède une faible capacité de multiplication.
[7] Larousse : Amas de cellules agrégées entre elles.
[8] Wiktionary : Conjugué immuno-enzymatique résultant d’un couplage chimique, par liaison covalente, entre un anticorps ou un fragment d’anticorps ayant conservé la capacité de reconnaître l’antigène choisi et une enzyme capable de libérer des ions ammonium ou autres produits réactionnels simples à partir de substrats bien tolérés chez les animaux supérieurs.
[9] Substance composée de molécules caractérisées par la répétition, un grand nombre de fois, d’un ou de plusieurs atomes ou groupes d’atomes.
[10] Larousse : Médicament ou traitement qui renforce ou complète les effets de la médication principale.
[11] Pharmacopée européenne, 7e édition, 2009. Monographie : Vaccins pour usage humain. 01/2009
[12] https://fr.vikidia.org/wiki/Vaccin
[13] R. DUNNING, Some observations on vaccination or the inoculated cowpox, March and Teape, Londres, 1800

Fév 1, 2021 | Environnement - Santé - Alimentation
Non, les vaccins contre la COVID-19 qui devraient prochainement être disponibles en Belgique ne contiennent pas de virus vivants atténués ou inactivés. Ils ne peuvent donc pas provoquer la maladie, mais il est possible que la personne vaccinée ait été infectée peu avant ou peu après l’injection. L’organisme a besoin de quelques semaines pour se protéger après la vaccination[1].
Depuis le début de cette étude, nous avons cherché les réponses à vos questions les plus fréquentes sur des sites fiables : sites d’informations sur les vaccinations, médias reconnus pour leur analyse impartiale des faits, … Les liens, en-dessous de toutes les pages, vous permettent de les consulter. En effet, ils sont plus détaillés que les réponses que nous avons voulues succinctes – et qui sont donc forcément incomplètes – afin d’en faciliter la lecture.
[1] Https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19/vaccins/questions_et_reponses_sur_les_vaccins_contre_la
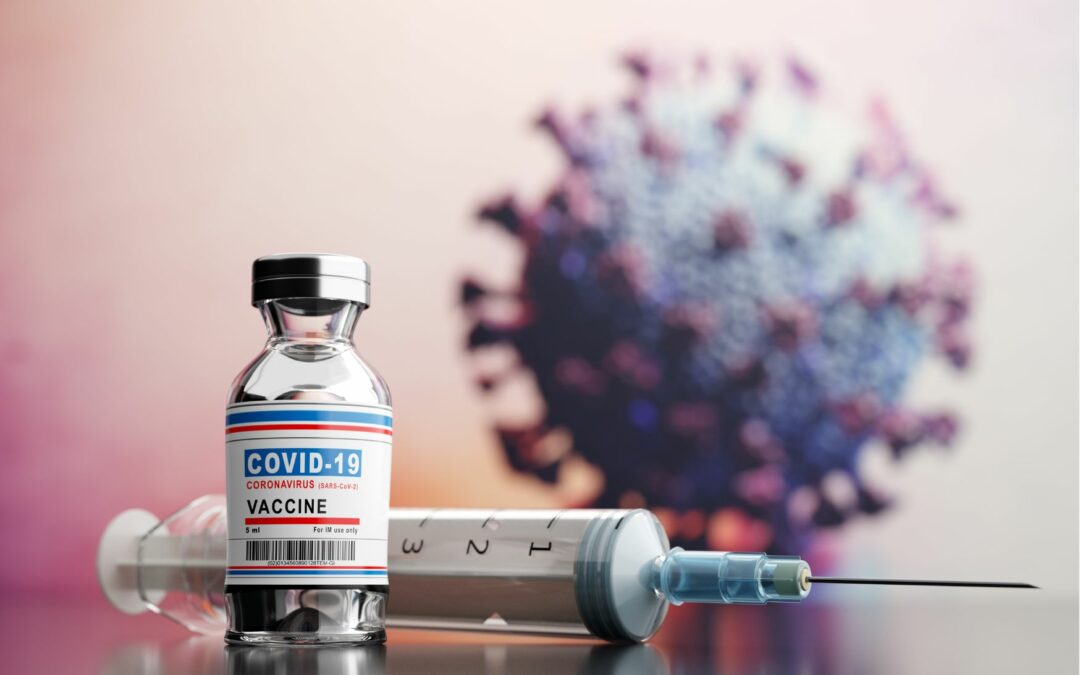
Fév 1, 2021 | Environnement - Santé - Alimentation
C’est la phase 3 du développement clinique d’un vaccin qui permettent d’observer un effet protecteur. Cela nécessite de vacciner un grand nombre de volontaires (plusieurs milliers de sujets). Ces essais incluent un maximum de variétés de groupes cibles (personnes âgées, patients aux antécédents pulmonaires ou cardiaques, diabétiques ou en surpoids. Ces études se font en double aveugle : Les volontaires reçoivent soit la dose du vaccin, soit un placebo. Les médecins pratiquant les tests et assurant le suivi ne savent pas quel patient a reçu le vaccin ou le placebo. L’efficacité du vaccin dépend du taux de positivité du virus parmi les personnes ne participant pas au tests et donc non vaccinée. Plus le nombre de malades non vaccinés augmente, plus l’efficacité du vaccin chez les volontaires vaccinés peut être démontrée. L’incidence du Coronavirus durant l’année 2020 a permis d’évaluer l’efficacité du vaccin rapidement[1].
Les preuves d’efficacité de ces vaccins proviennent de deux vastes essais cliniques de phase 3 randomisés, en double aveugle et avec un groupe placebo, c’est-à-dire procurant le plus haut niveau de preuve scientifique. Ces deux essais (l’un de 43000 participants environ, l’autre de 30000 participants environs) montrent une efficacité de 94%[2].
Depuis le début de cette étude, nous avons cherché les réponses à vos questions les plus fréquentes sur des sites fiables : sites d’informations sur les vaccinations, médias reconnus pour leur analyse impartiale des faits, … Les liens, en-dessous de toutes les pages, vous permettent de les consulter. En effet, ils sont plus détaillés que les réponses que nous avons voulues succinctes – et qui sont donc forcément incomplètes – afin d’en faciliter la lecture.
[1] Lire par ailleurs
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19/vaccins/questions_et_reponses_sur_les_vaccins_contre_la
[2] Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française, Suisse, Ibid.