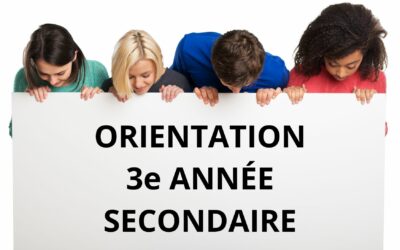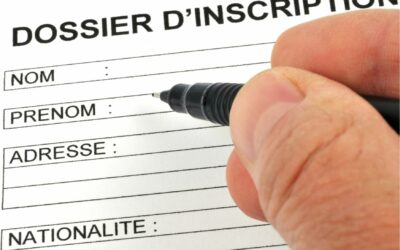Notre actualité
Troisième année orientante
Désormais, pour la troisième année, on ne parle donc plus de tronc commun mais de « tronc commun modalisé ». Ainsi, les écoles secondaires qui organisent des filières qualifiantes pourront commencer à y préparer leurs élèves dès la troisième et proposeront une offre en fonction de leurs propres sections.
Un vrai tronc commun
Un vrai Tronc Commun, Un Tronc Commun de Qualité, voilà les sous-titres de notre conférence de presse d’il y a un an, le 27 septembre 2018.
Le Tronc Commun Polytechnique est-il acquis ? Qu’en dit la DPC ? Pas grand chose …
Le Décret inscription est mort, vive le Décret inscription
La Une des médias à la suite de la déclaration de politique communautaire (DPC) titraient à l’unanimité « Abrogation du décret inscription ! » Sensation et, frisson garantis à la lecture de la DPC qui nous annonce l’abrogation des articles du décret « missions » organisant les inscriptions en première secondaire simultanément remplacés par d’autres mesures. Comme si par magie, tout à coup, facilement, des nouvelles mesures tiendront compte des réalités par bassins et poursuivront bien l’objectif de mixité sociale.
Ecole : La Déclaration de Politique Communautaire inquiète !
La Déclaration de Politique communautaire a déjà fait couler beaucoup d’encre. Nous allons en remettre une couche en approfondissant les sujets déjà abordés tout en ajoutant d’autres, tout aussi importants que les premiers, mais dont on parle moins.
Les troubles spécifiques des apprentissages ou « DYS » 1. Dyslexie et dysorthographie
De manière générale, les aménagements raisonnables que l’on met en place pour un élève doivent être généralisés à tous les autres élèves, qu’ils aient ou non un ou des troubles spécifiques des apprentissages. Tel est l’idée de l’enseignement inclusif. En permettant à tous les élèves de bénéficier des mêmes facilités, on évite non seulement la stigmatisation (risque important quand on différencie dans une classe) mais cela permet à tous les autres élèves, sans besoins spécifiques mais qui ont des difficultés d’apprentissage, d’en bénéficier. C’est aussi introduire un peu de justice dans les apprentissages.
Analyse : Les troubles spécifiques des apprentissages ou « DYS »
Notre premier objectif, ici, est de permettre aux professionnels de terrain (directions d’écoles, enseignants, éducateurs, assistants sociaux, travailleurs en écoles de devoirs, maisons de jeunes, SAS, AMO, etc.) d’expliquer aux familles ce qu’est un trouble DYS et ce qu’il y a lieu faire pour obtenir un diagnostic. Il s’agit surtout de dédramatiser l’annonce de la suspicion d’un trouble spécifique de l’apprentissage (voir le chapitre sur les effets positifs des DYS, page 6) afin d’encourager les familles à s’adresser à un spécialiste. L’objectif d’un diagnostic est de permettre aux enseignants de mettre en place des aménagements raisonnables et des pratiques pédagogiques adaptées, afin de diminuer le plus possible les « situations » de handicap auxquelles l’enfant atteint d’un trouble spécifique des apprentissages est confronté dans sa scolarité.
Analyse : L’intégration en enseignement inclusif : une question de droits.
Un enseignement inclusif est destiné aux enfants en situation de handicap, c’est-à-dire les enfants qui présentent des incapacités durables. Ces incapacités peuvent être physiques, mentales, intellectuelles et sensorielles. Ces incapacités entrent en interaction avec diverses barrières qui font obstacle à leur pleine participation à la société sur base de l’égalité avec les autres. La notion de situation de handicap est vaste et complexe, et concerne un nombre très important d’enfants (et d’adultes). Il ne s’agit pas seulement de handicaps intellectuels ou physiques : il peut également s’agir de maladies chroniques ou graves, ou d’élèves avec troubles de l’apprentissage (« dys »). La Convention ONU s’applique pour tous ces enfants, de même que la législation anti-discrimination, et ceux-ci ont droit à la mise en place d’aménagements raisonnables.
Les devoirs à domicile : conclusions
Les devoirs participent à la sélection. Mais il y a des écoles qui refusent ce système et cherchent à retarder ce tri injuste le plus longtemps possible. Du moins, tant que les élèves sont en leur sein. Pour cela, et afin de diminuer les inégalités sociales et d’apprentissage, elles mettent en place de véritables projets pédagogiques. « Véritables », parce que basés sur une pédagogie validée par de nombreuses recherches en sciences de l’éducation. Citons pêle-mêle à commencer par les plus connues, dans le désordre et sans être exhaustifs, les pédagogies Freinet, Montessori, Freire, Decroly, Steiner-Waldorf, l’Ecole nouvelle et active de Ferrière, en passant par l’apprentissage coopératif, la pédagogie universelle, la pédagogie différenciée, la pédagogie explicite et, enfin, celle qui doit accompagner toutes les autres, la pédagogie institutionnelle de Fernand Oury.
Les devoirs doivent être corrigés. Comment font les professeurs ?
Les devoirs participent à la sélection. Mais il y a des écoles qui refusent ce système et cherchent à retarder ce tri injuste le plus longtemps possible. Du moins, tant que les élèves sont en leur sein. Pour cela, et afin de diminuer les inégalités sociales et d’apprentissage, elles mettent en place de véritables projets pédagogiques. « Véritables », parce que basés sur une pédagogie validée par de nombreuses recherches en sciences de l’éducation. Citons pêle-mêle à commencer par les plus connues, dans le désordre et sans être exhaustifs, les pédagogies Freinet, Montessori, Freire, Decroly, Steiner-Waldorf, l’Ecole nouvelle et active de Ferrière, en passant par l’apprentissage coopératif, la pédagogie universelle, la pédagogie différenciée, la pédagogie explicite et, enfin, celle qui doit accompagner toutes les autres, la pédagogie institutionnelle de Fernand Oury.