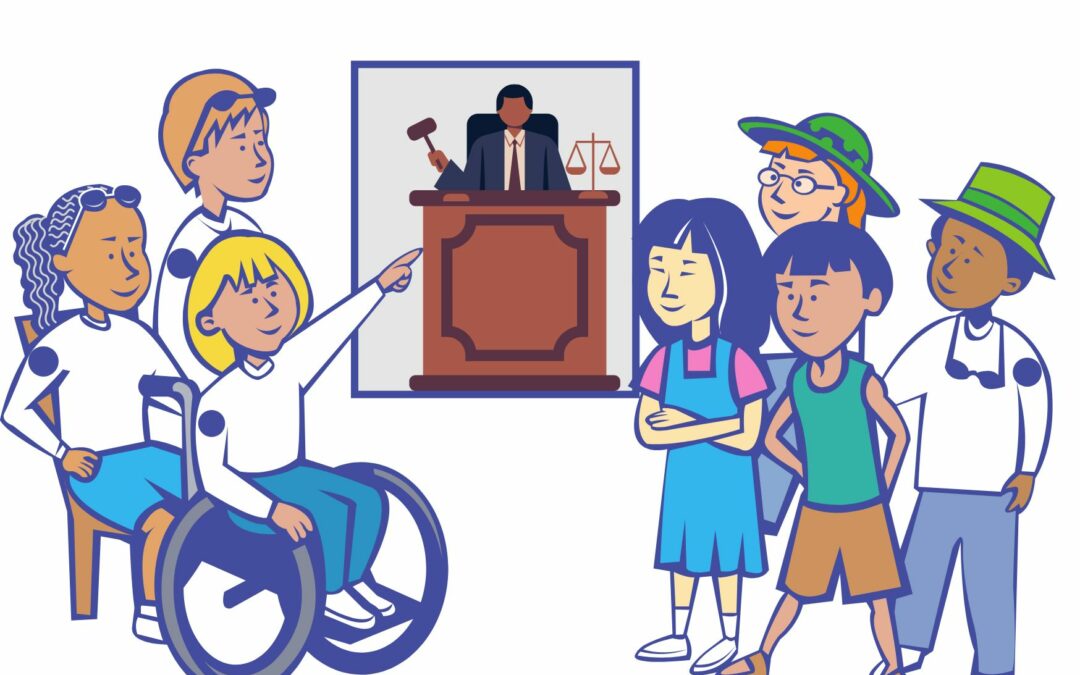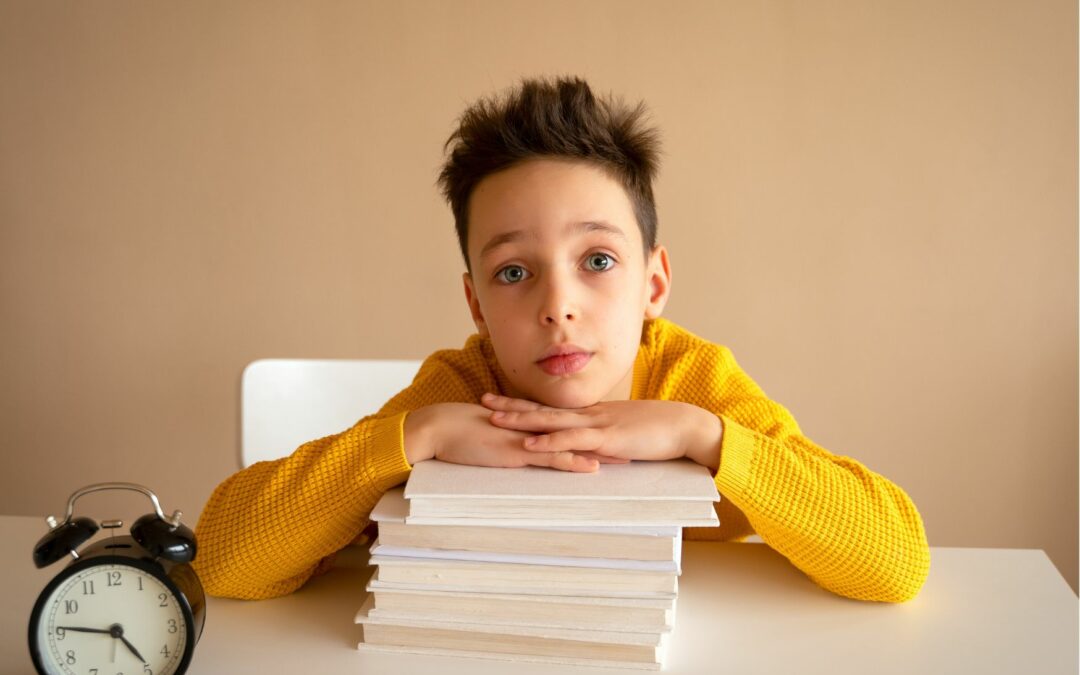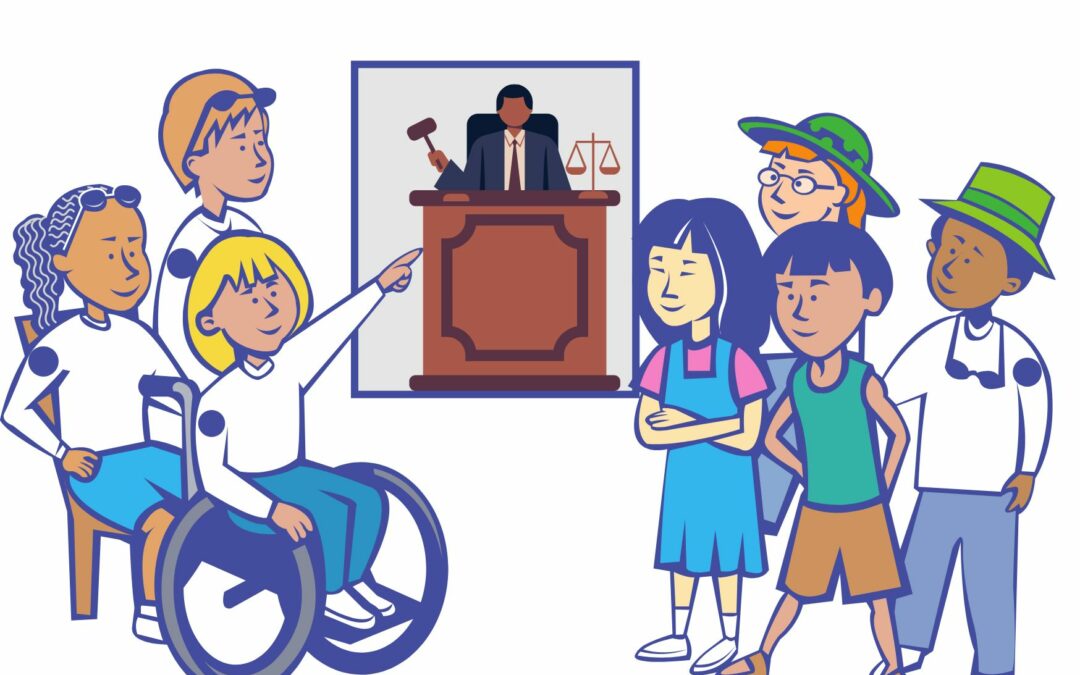
Sep 8, 2019 | Ecole - Education - Inclusion
Depuis 2004, et surtout 2009, de
plus en plus d’enfants sont intégrés dans l’enseignement ordinaire alors
qu’auparavant ils étaient dirigés vers l’enseignement spécialisé. Il est utile
de se questionner sur les raisons de cette dynamique, sur les motivations qui
animent la Communauté française[1]
visant l’intégration d’enfants en situation de handicap dans un enseignement
« ordinaire » qui n’est pas habitué à les accueillir.
Par la même occasion,
profitons-en pour questionner l’avenir de l’enseignement spécialisé. Est-il en
sursis ? Comment va-t-il évoluer ? Sur ces questions, je ne pourrai
qu’hypothéquer – n’étant pas dans les petits papiers de nos décideurs
politiques – mais dans le cadre d’une évolution dont nous verrons qu’elle est
inéluctable.
Enfin, nous sommes tous concernés
par l’inclusion et les aménagements raisonnables. Aujourd’hui, il n’est pas une
classe, pas un enseignant qui n’ait, face à lui, au moins un enfant en situation
de handicap. Il est donc important de comprendre ce que l’on entend par là et
nos obligations légales qui découlent du Décret anti-discrimination[2].
L’intégration scolaire
L’intégration scolaire n’est pas
neuve. Depuis toujours, des écoles et des enseignants de l’«ordinaire[3] »
intègrent des enfants porteurs de handicaps physiques ou intellectuels sans que
ceux-ci ne fréquentent (peu ou prou) l’enseignement spécialisé. Cela avec
beaucoup de bienveillance, plus ou moins de bonheur et, surtout, énormément de
difficultés. Au siècle passé, on parlait d’ « intégrations scolaires
pirates », car il n’y avait pas de cadre légal pour les organiser. Cela a
changé le 3 mars 2004 ; le Décret organisant l’enseignement spécialisé, modifié
par le décret du 5 février 2009 contenant des dispositions relatives à
l’intégration des élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire, organise
l’intégration scolaire en partenariat avec l’enseignement spécialisé.
Dès lors, depuis 2004, la
question n’est plus de savoir si, de manière générale, l’intégration d’enfants
à besoins spécifiques dans l’ordinaire est ou non une bonne chose. Aujourd’hui,
il s’agit, tout simplement, d’un droit fondamental[4].
Ce droit avait déjà été défini une première fois par la Convention
internationale des Droits de l’Enfant (20 novembre 1989) qui, en plus du droit
à l’éducation sur base de l’égalité des
chances (art 28 de la CIDE), parlait de concevoir l’aide fournie (…) de telle sorte que les enfants handicapés
aient effectivement accès à l’éducation, à la formation (…), à la préparation à
l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon
propre à assurer une intégration sociale
aussi complète que possible et leur épanouissement personnel (…)
(article 23 de la CIDE). Depuis 2006, la Convention des Droits des Personnes
handicapée (ONU) a renforcé ce droit.
La Convention ONU de 2006 : un changement de paradigme
Avant 2006, on parlait d’un modèle médical du handicap. Les adultes
et les enfants handicapés étaient « objets » de droits et
la société et ses institutions (dont l’école) trouvaient normal de décider
pour eux. Cette notion a été remplacée dans la Convention par le modèle social du handicap. Les
personnes en situation de handicap sont enfin devenues « sujets » de
droits. Elles peuvent donc décider pour elles-mêmes et la société se doit de
respecter ce droit fondamental, sans plus décider à leur place.
Le handicap n’est plus seulement
un problème médical mais le résultat d’une interaction avec des barrières
environnementales. Ainsi, la maladie ou le handicap ne sont plus des
problèmes. Les problèmes se trouvent dans l’environnement qui n’est pas adapté
aux spécificités de la personne handicapée. C’est donc parce que
l’environnement (rues, bâtiments, écoles, professionnels, …) n’est pas suffisamment
adapté que ces personnes ne peuvent participer, sur pied d’égalité, à la vie en
société.
Prenons l’exemple d’un enfant en
chaise roulante : au XXe siècle, le modèle médical était de considérer que
cet enfant avait eu une maladie ou un accident qui l’empêchait de faire usage
de ses jambes. Si, en conséquence, il n’avait plus accès à son école parce que
celle-ci n’était pas équipée de rampes et/ou d’ascenseur, c’était bien triste,
mais on pouvait lui trouver une place dans une école adaptée pour enfants avec
handicap physique. On le privait évidemment de son milieu social mais on
répondait à son problème physique. Le modèle social aujourd’hui affirme que c’est
parce qu’il n’y a pas de rampes d’accès dans tous les bâtiments scolaires, dans
tous les transports, etc., que cet enfant ne sait pas participer à la vie en
société. Il faut donc mettre en place des aménagements raisonnables[5]
qui lui permettront de bénéficier d’un enseignement inclusif.
L’enseignement inclusif. Pour qui ?
Un enseignement inclusif est destiné aux enfants en situation de handicap, c’est-à-dire les
enfants qui présentent des incapacités durables. Ces incapacités peuvent
être physiques, mentales, intellectuelles et sensorielles. Ces incapacités
entrent en interaction avec diverses barrières qui font obstacle à leur pleine
participation à la société sur base de l’égalité avec les autres. La notion de situation de handicap est vaste et
complexe, et concerne un nombre très important d’enfants (et d’adultes). Il ne
s’agit pas seulement de handicaps intellectuels ou physiques : il peut
également s’agir de maladies chroniques ou graves, ou d’élèves avec trouble·s
de l’apprentissage (« dys »).
La Convention ONU s’applique pour tous ces enfants, de même que la législation
anti-discrimination, et ceux-ci ont droit à la mise en place d’aménagements
raisonnables.
Comprendre le principe d’inclusion
Il y a quatre manières de définir
la place de personnes en situation de handicap dans la société et, par
corollaire, de définir la place des enfants à l’école[6] :
- L’exclusion : concerne les enfants en
situation de handicap qui ne sont pas scolarisés. Ils sont à charge de leurs
familles ou sont placés en centres d’accueil non scolaires. L’exclusion
concerne quelques centaines d’enfants en CF ;
- La ségrégation : les enfants en situation
de handicap sont placés dans un environnement différent que les personnes sans
handicap. C’est le cas de l’école spécialisée. Dans notre enseignement, il y a
une école pour les enfants sans handicap et une école spécialisée pour les
enfants avec handicap. L’enseignement spécialisé accueille environ 36 600
enfants en CF[7].
- L’intégration : ce sont les mesures qui
sont prises dans certaines conditions par la Communauté française et qui
permettent à certaines enfants en situation de handicap d’intégrer la vie en
société. Dans ce système, on ne parle pas d’une réelle mixité : l’école
ordinaire s’adapte à l’enfant et l’enfant doit s’adapter à l’école.
L’intégration concerne un peu plus de 3 000 enfants en CF.
- L’inclusion : Dans un système inclusif, tout
est réfléchi dès le départ pour avoir un environnement adapté à l’ensemble des
diversités de la population quelles qu’elles soient, y compris les personnes en
situation de handicap[8].
Pour respecter ses engagements
vis-à-vis de l’ONU, la Communauté française doit mettre en place des écoles
inclusives et donc :
- interdire l’exclusion de l’enseignement général ordinaire,
- imposer un enseignement (primaire + secondaire) inclusif de qualité et gratuit à tous les niveaux,
- imposer des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun,
- mettre en place un accompagnement nécessaire et individualisé[9],
- le tout dans un environnement qui optimise le progrès scolaire et la socialisation.
Lire la suite de l’analyse
[1]
Cette dynamique concerne également les autres Communautés de Belgique, mais
également la plupart des pays qui ont un système démocratique.
[2]
Décret de la
C.F., relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination du
12-12-2008 (M.B. 13-01-2009)
[3]
On parle, en général, d’enseignement « ordinaire » pour le
différencier de l’enseignement « spécialisé ». De même, on parle
d’enfants « ordinaires » pour les différencier des enfants « en
situation de handicap ».
[4]
Cela ne veut pas dire que tous les enfants « doivent »
être intégrés, mais qu’ils en ont le droit, en fonction de leur intérêt supérieur (article 3 de la
CIDE) : « Dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale. ».
[5]
Un
aménagement raisonnable est une mesure concrète permettant de réduire, autant
que possible, les effets négatifs d’un environnement inadapté sur la
participation d’une personne à la vie en société (in A l’école
de ton choix avec un handicap – Unia).
[6] Mais
également toute personne en situation de handicap dans la société.
[7]
36 609 enfants en 2015 – Source Indicateurs de l’enseignement 2016, p23.
[8] Dans un
système inclusif, les deux types d’enseignement (ordinaire et spécialisé)
collaborent étroitement et se complètement mutuellement : ils sont
intégrés.
[9] Où l’enseignement spécialisé a un rôle à jouer.
[10] Observations finales du Comité ONU à la Belgique
[11]
Selon l’avis °3 du
Pacte, L’école inclusive est définie comme « permettant à un élève à besoins spécifiques de poursuivre sa
scolarité dans l’enseignement ordinaire moyennant la mise en place d’aménagements
raisonnables d’ordre matériel, pédagogique et/ou organisationnel ».
[12] Sur
ces points, nous sommes maîtres de nos formations personnelles (ce n’est pas la
littérature pédagogique qui manque), ainsi que de nos pratiques pédagogiques
qui visent la progression de tous les enfants au mieux de leurs capacités.
[13] Nous
avons une liberté pédagogique qui nous permet la mise en place, dans nos
classes, de pédagogies adaptées. Le fait de les mettre en place nous-mêmes –
avant que cela ne nous soit imposé – permet de nous sentir bien, nous aussi,
dans le processus inclusif.

Sep 8, 2019 | Ecole - Education - Inclusion
1. Il y a des solutions
Évidemment, les solutions existent et il ne faut pas les chercher bien loin.
La première solution – et la meilleure – n’est pas de faire comme les prétendument « bonnes » écoles[1], mais comme les écoles qui ont un véritable projet pédagogique. Donc, celles qui font de la pédagogie active.
Notre société est sans
doute condamnée à devoir supporter ces « bonnes » écoles longtemps
encore tant est forte la demande des « bonnes » familles (mais c’est
aussi la demande des fédérations d’employeurs) de pratiquer une sélection afin
de préserver leurs « bons » enfants et de diriger les enfants des
autres (les « mauvais ») vers des formations qui en feront les
ouvriers, les serviteurs et les petites mains de leur propre progéniture. « Si on envoie tout le monde à l’université,
qui m’apportera mon courrier ou réparera mon gros S.U.V. polluant quand il est
en panne ? »
Les devoirs
participent à la sélection. Mais il y a des écoles qui refusent ce système et
cherchent à retarder ce tri injuste le plus longtemps possible. Du moins, tant
que les élèves sont en leur sein. Pour cela, et afin de diminuer les inégalités
sociales et d’apprentissage, elles mettent en place de véritables projets
pédagogiques. « Véritables », parce que basés sur une pédagogie
validée par de nombreuses recherches en sciences de l’éducation. Citons
pêle-mêle à commencer par les plus connues, dans le désordre et sans être
exhaustifs, les pédagogies Freinet, Montessori, Freire, Decroly,
Steiner-Waldorf, l’Ecole nouvelle et
active de Ferrière, en passant par l’apprentissage coopératif, la
pédagogie universelle, la pédagogie différenciée, la pédagogie explicite et,
enfin, celle qui doit accompagner toutes les autres, la pédagogie
institutionnelle de Fernand Oury.
Il y a choix en la matière. Il est donc étonnant que nombre de nos écoles fassent de l’A-pédagogie frontale (notez le « A » privatif). Autrement dit, elles n’enseignent pas. On y donne cours, les professeurs y donnent leçons… et devoirs. Pourtant, cela reste encore celles que les bourgeois et ceux qui ne connaissent rien à la Pédagogie encensent. Fort heureusement, de nouvelles familles (de la middle-class non snobinarde), ayant eu la chance d’aller longtemps à l’école recherchent précisément les écoles à pédagogies active[2]. Dès que l’une de celles-ci s’ouvre dans un quartier populaire qui était précédemment fui par les populations plus aisées, ces familles font la file pour y inscrire leurs enfants, alors que les familles populaires, plus réticentes par rapport à ce qu’elles ne connaissent pas, s’y retrouvent finalement en minorité.
L’école des « devoirs », celle de la compétition, de la sélection, de la maltraitance n’est décidemment pas une bonne école, même si elle s’en revendique. Pour changer, elle n’a qu’une alternative, devenir active et donc respectueuse des rythmes des élèves.
C’était la première
solution, loin d’être la plus simple car elle nécessite un investissement
important pendant les premières années, mais certainement la solution la plus
citoyenne.
Seconde solution,
celle que nous recommandons aux croyants du Darwinisme social, c’est-à-dire, à
celles et ceux qui sont convaincus de l’utilité de la sélection d’enfants
innocents pour satisfaire les classes sociales les plus aisées. Cette sélection
à laquelle eux-mêmes ont échappé car inscrits dans une école qui a d’abord
sélectionné leurs petits camarades de classe pour la « casse ».
A ces experts du « On ne peut pas faire réussir tout le monde,
ma bonne dame », nous disons : « Quitte à donner des devoirs,
autant de rester dans la légalité. C’est non seulement une question étique,
mais aussi de crédibilité. Comment un professeur qui serait hors-la-loi
pourrait-il exiger de ses élèves qu’ils respectent les règles de
« son » cours, celles qu’il a édictées en maître divin (ou en dieu
vivant, c’est selon…) ? »
Un professeru se doit de donner l’exemple. Si une loi est édictée, chaque citoyenne, chaque citoyen se doit de la respecter. Surtout si elle a été votée par celles et ceux qui nous représentent politiquement. Cela s’appelle la Démocratie, contrairement à ce qui se passe dans nombre de « bonnes » écoles où cette Démocratie n’a plus (ou jamais eu) cours.
Dès lors, si vous
enseignez en primaire, en Belgique francophone (pour les autres pays ceci est
parfaitement adaptable, ne mange pas de pain et vous gardera l’estime de vos
collègues élitistes et des familles BCBG qui sont les prétendues « élites »
de votre population scolaire), il suffit de ne donner des « travaux à
domicile » tels que décrits plus haut : 0 minutes avant 6 ans, 10
minutes de moyenne de 6 à 8 ans, 20 minutes de moyenne de 8 à 10 ans et enfin
30 minutes maximum de 10 à 12 ans.
Mais, vous êtes en secondaire ? Cela ne change rien, sinon que si vous voulez devenir progressivement un enseignant respectueux de TOUS vos élèves, vous allez devoir vous concerter avec vos collègues, afin de vous mettre d’accord pour ne pas dépasser les règles suivantes. Dans le cas d’espèce ou vous tenez aux devoirs, évidemment :
- 30 à 35 minutes de travaux à domicile à faire seul,
maximum 4 fois par semaine, entre 12 et 14 ans ;
- 35 à 40 minutes de travaux à domicile à faire seul,
maximum 4 fois par semaine, entre 14 et 16 ans ;
- 40 à 45 minutes de travaux à domicile à faire seul,
maximum 4 fois par semaine, entre 16 ans et la fin du secondaire.
Pourquoi quatre fois maximum ? Simplement pour respecter les droits fondamentaux de vos élèves et l’article 31 de la Convention Internationale des Droits de vos élèves (ONU 1989). Cette moyenne doit être estimée sur base des élèves ayant les plus grandes difficultés.
Au-delà de ces deux propositions, vous serez dans l’illégalité (sauf en secondaire ou tous les coups bas[3] et toutes les discriminations sont permis).
On l’a dit, des solutions existent : des écoles
qui ont un véritable projet pédagogique (donc une pédagogie active) ne donnent
que peu de travaux à domicile à faire à la maison. Les enseignants-pédagogues
savent que le seul lieu des apprentissages est la classe. Dès lors, le travail
à faire à la maison est restreint, les élèves savent exactement ce que l’on
attend d’eux et le travail se fait sans l’aide des parents. Les écoles Freinet,
par exemple, font le pari que les parents ne demandent des devoirs que parce
que c’est souvent le seul lien qu’on leur propose avec ce qui se passe en classe.
Si on leur propose d’autres modalités de communication avec les enseignants,
d’autres façons d’accompagner la scolarité de leurs enfants, ils les adopteront
bien vite ! Il faut que les enfants montrent à la maison ce qu’ils ont fait en
classe, pas qu’ils montrent en classe ce qu’ils ont fait à la maison.
Et le
message de Christian, enseignant Freinet aux parents de sa classe :
Aux parents :
Notre objectif, Parents et Enseignants, est d’aider au mieux vos Enfants à cultiver le goût, l’envie d’aller à l’Ecole pour apprendre et surtout pour comprendre et construire en confiance leurs savoirs.
A la maison, après l’Ecole, on goûte, on parle, on raconte, on discute, on lit, on joue…
Vous pouvez goûter, parler, raconter, discuter, lire et jouer avec votre Enfant.
Christian.
2. Rappelons-nous que l’échec scolaire tue !
Au-delà du problème des devoirs, c’est du bien-être de tous les élèves qu’il s’agit. Est-il un enseignant celui qui donne des devoirs pour ne pas être traité de laxiste par ses collègues ou par des parents ? A-t-elle de l’empathie pour ses élèves celle qui, pour être bien vue de sa directrice, force leçons et révisions à faire à la maison ? Peut-on se trouver devant des jeunes dans l’espoir de les former à un esprit critique quand on refuse, soi-même, d’analyser une situation aussi élémentaire que celle des devoirs à domicile, qui impacte la vie de millions de jeunes et de leurs familles, génère la discrimination, l’échec scolaire et la haine, parmi les plus fragiles de notre société ?
Les devoirs sont interdits mais les journaux de classe pré-imprimés comprennent toujours les trois rubriques : devoirs – leçons – notes. Tant que le politique ne veillera pas à ce que les écoles qu’il subsidie – et par là-même les éditeurs et imprimeurs – respectent les lois, les élèves continueront à passer leurs après-journées à se fatiguer plus encore et à voir leurs droits au repos, aux loisirs, à la découverte de l’art et d’une autre culture que celle enseignée à l’école, non respectés.
Et s’il est bien un pilier qui doit tenir cette
société debout, en formant des citoyennes et des citoyens à co-construire le
droit – et donc la Justice – et à le respecter, c’est l’institution scolaire.
Celle-ci n’a jamais rempli son rôle, étant elle-même un lieu de non-droits. «
Faites ce que je dis et non ce que je fais » est sa devise cachée.
Les devoirs ne sont que la pointe de l’iceberg de l’échec scolaire. Ils y participent mais font partie d’un tout élaboré pour pratiquer la sélection des élites et la relégation des enfants de milieux moins favorisés. Et donner des devoirs participe à ce système discriminant tout en se donnant le beau rôle : « Si tu es en échec, c’est parce que tu n’as pas étudié », sans remettre en cause l’incohérence du système et ses propres pratiques.
Contrairement à ce que pensent certains
chercheurs, nous ne partageons pas l’idée que les devoirs à domicile
représenteraient un compromis social entre l’école et les familles le moins
mauvais possible, malgré la demande des familles. L’enseignement a beaucoup
changé depuis que les parents ou grands-parents sont passés par l’école.
Apprendre une leçon signifiait souvent apprendre par cœur un contenu
encyclopédique plutôt que des notions étudiées en classe. Aujourd’hui, pour
bien faire, apprendre une leçon devrait prendre un tout autre sens et
représenter un travail bien plus exigeant et complexe que les familles ne sont
plus capables d’assumer, pour les raisons que nous avons évoquées plus haut.
Or, si pour 82 % des professeurs, une des
raisons pour lesquelles ils donnent des devoirs est de favoriser le lien
école-famille, seulement 35 % des parents partagent cette idée.
Oui, l’échec scolaire tue. Les suicides
d’adolescents sont la deuxième cause de mortalité après les accidents de la
route . Et les devoirs, comme tout le reste de l’iceberg, font partie de ce
harcèlement psychologique mis en place par l’école pour culpabiliser les jeunes
qui vivent l’échec au quotidien. L’école est un important lieu de risques
psychosociaux pour les élèves. Les phobies scolaires touchent environ 5 % des
élèves âgés de 12 à 19 ans (soit au moins un par classe). L’échec scolaire
engendre le sentiment d’incompétence acquise qui fera boule de neige et mènera
vers plus d’échecs encore. La compétition entre les élèves et la pression des
professionnels de l’école et/ou des parents amène du stress et de la
souffrance. Des élèves vivent mal leurs différences (handicap, difficultés
d’apprentissage, préférences sexuelles, transsexualité, …) et leurs échecs.
Enfin, quelle est la part des problèmes vécus à l’école dans les tentatives (ou réussites) de suicides des adolescent·e·s ? Si, souvent il n’est pas le seul critère qui mène au désespoir et aux idées de suicide, il n’est pas innocent de penser que c’est la goutte de trop, celle qui mène au passage à l’acte. Dans toute tentative de suicide d’un enfant, l’échec scolaire doit être questionné. Les devoirs en font partie !
[1] Les prétendument « bonnes » écoles
sont celles qui donnent devoirs et leçons, celles qui mettent les élèves en
compétition en leur distribuant des notes au mérite, ce qui leur permet de
pratiquer une sélection entre les soi-disant « bons élèves » et les prétendus «
moyens » ou « mauvais » élèves. Ces derniers étant tous des Mozart qu’on
assassine au nom de la méritocratie bourgeoise. En fait, les prétendument « bonnes
» écoles, sont les plus mauvaises !
[2] Notez que le terme « pédagogie
active » est un pléonasme. Par définition, une pédagogie est
« active ». Ce sont les enseignements frontaux, ceux qui ne mettent
pas les élèves en action qui ne sont pas des pédagogies actives. Ce ne sont,
d’ailleurs, pas des pédagogies du tout !
[3] Synonyme : traîtrises

Sep 8, 2019 | Ecole - Education - Inclusion
Si les devoirs volent
du temps familial, ils en volent aussi à l’école et donc au temps d’apprentissage
des élèves. Le maître doit vérifier que les devoirs ont été bien faits et les
corriger. Cela se fait parfois dans la classe durant le cours, ou alors le
professeur reprend la pile de devoirs à corriger chez lui.
Le temps de correction est généralement inefficace en termes d’apprentissages, ou est une charge de plus pour le maître. Ceci est sans doute la raison qui explique que plus de 50% des professeurs belges ne vérifient pas ou peu les devoirs faits à la maison. La Belgique est parmi les pays où les devoirs sont les moins corrigés et donc, parmi plus mauvais élèves de la classe avec la Suède et la Finlande[1].
Tout ça pour ça…. !!!
Et pour finir : Conclusions : Il y a des solutions, mais rappelons-nous que l’échec scolaire tue !
[1] Isac Maria Magdalena et al. Teaching practices in primary and secondary schools in Europe: Insights
from large-scale assessments in education. Luxembourg : Commission européenne. 2015

Sep 8, 2019 | Ecole - Education - Inclusion
Un enseignant ne donne pas de devoirs ou peu ! Par contre, un professeur, si ! Mais, est-il pour autant hors-la-loi ?
Si en France les devoirs sont interdits depuis
1956, dans l’enseignement francophone belge les « travaux à
domicile » sont régulés depuis 2001[1] uniquement
pour l’enseignement primaire[2].
Il s’agit donc d’une OBLIGATION que doit respecter chaque… professeur !
Les travaux à domicile
sont ainsi définis : « activité dont
la réalisation peut être demandée à l’élève, en dehors des heures de cours, par
un membre du personnel enseignant. Cette définition englobe donc tous les
travaux que selon les écoles, on nomme devoirs, leçons ou encore activités de
recherche ou de préparation, … Les
dispositions prévues concernent donc bien toutes ces activités et pas
uniquement ce qu’il est coutumier d’appeler « devoirs » [3]».
Les travaux à domicile
sont une faculté laissée aux écoles, pas une obligation qui leur serait faite. Cela
signifie que les équipes éducatives qui souhaiteraient fonctionner sans travaux
à domicile peuvent bien entendu le faire. Certaines le font déjà. D’autres y
réfléchissent.
Les travaux à domicile
sont interdits à l’école maternelle. En première et deuxième années primaires,
les travaux à domicile sont interdits, mais certaines activités sont autorisées
(de courtes activités par lesquelles il est demandé à l’élève de lire ou de
présenter à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé ou construit en
classe sont, par contre, autorisées).
Pour chaque élève, la
durée journalière de ces travaux ne peut excéder 20 minutes en 3ème et 4ème
primaires et 30 minutes en 5ème et 6ème. Il s’agit ici d’une référence que
chaque enseignant doit avoir à l’esprit quand il définit les travaux à
domicile. Il ne s’agit évidemment pas d’un strict minutage chronométré pour
chaque enfant.
Les travaux à domicile
doivent être adaptés au niveau d’enseignement et doivent toujours pouvoir être
réalisés sans l’aide d’un adulte. Les travaux à domicile doivent être conçus
comme le prolongement d’apprentissages déjà réalisés durant les périodes de
cours. Les travaux à domicile doivent prendre en compte le niveau de maîtrise
et le rythme de chaque élève. Ils ne peuvent jamais donner lieu à une cotation.
Il doit être accordé un délai raisonnable à l’élève pour la réalisation.
Mais, soyons clair,
pour tout enseignant un peu pédagogue qui se respecte, l’essentiel du travail se fait en
classe. Les devoirs ne devraient être une exception qu’en fin de secondaire. En
effet, une étude australienne a montré que les
élèves étudiant dans un pays où le temps consacré aux devoirs est important,
ont de moins bons résultats au Programme international pour le suivi des acquis
des élèves (Pisa) effectué tous les trois ans depuis 2000, ainsi qu’aux examens
mis en place par les écoles elles-mêmes. Selon l’étude, surcharger les enfants
de travail en primaire n’améliore pas leurs résultats, ça paye un peu plus au
collège si les élèves reçoivent une aide. C’est seulement à partir de l’âge de
15 ans, c’est-à-dire durant les années lycée, que les devoirs «renforcent les
performances scolaires des élèves»[4].
Donc, comme professeur en section primaire, si je dépasse les prescrits, je suis par définition hors-la-loi. Dès lors, comment serai-je encore crédible auprès de mes élèves quand je leur demanderai de respecter le règlement de la classe ou de l’école. Un hors-la-loi peut-il être plausible quand il demande aux élèves de faire ce que lui-même se refuse de faire ?
En secondaire, les professeurs devraient se référer à l’étude ci-dessus qui en confirme d’autres, à savoir que les travaux à domicile ne sont efficaces qu’en fin de secondaire et à certaines conditions (relire « Des bénéfices pas toujours démontrés »). Avant cela, comme cela a été démontré, on sait combien les devoirs à domicile n’apportent rien.
A suivre… Les devoirs doivent être corriges. Comment font les professeurs ?
[1] Dans le décret Missions, l’article
78 §4 fut modifié par ce décret du 27 mars 2001.
[2] Durant la législature 1999-2004, nous avons eu
deux ministres de l’enseignement. Un pour le fondamental et un autre pour le
secondaire. C’est le premier qui a œuvré dans le sens de la défense des droits
de l’enfant. L’école secondaire a eu moins de chance…
[3] Circulaire n° 57 : Régulation
des travaux à domicile dans l’enseignement fondamental. Décret du 29 mars 2001
[4] Slate Live, 3 avril 2012 Trop de devoirs tue la
réussite scolaire
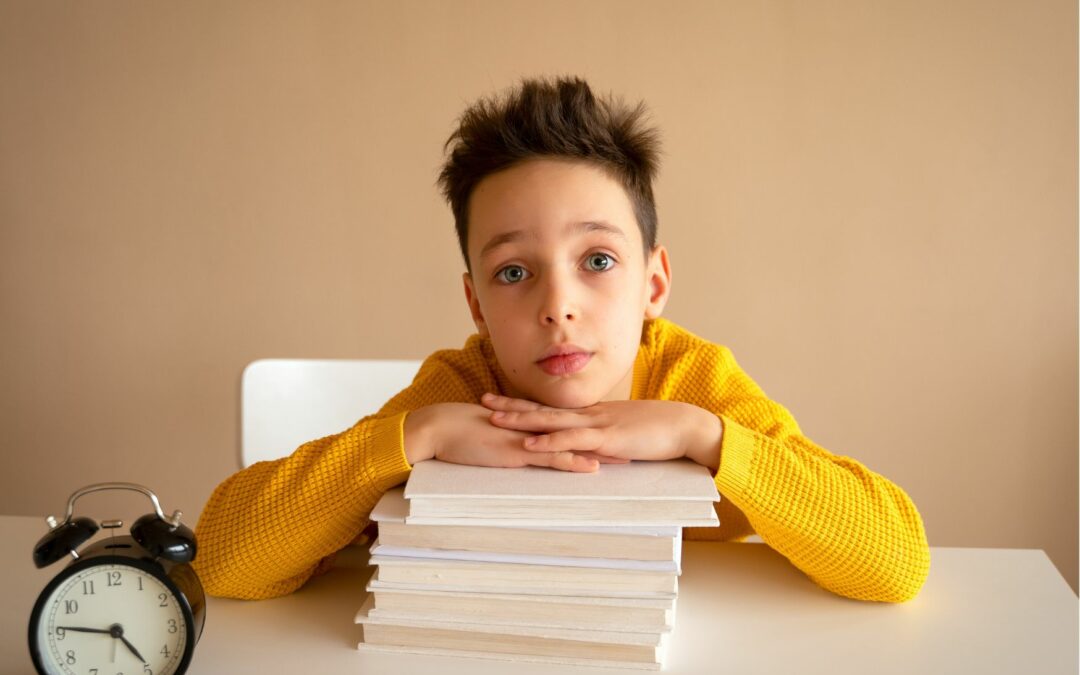
Sep 8, 2019 | Ecole - Education - Inclusion
L’efficacité des devoirs est une vieille question qui
anime les acteurs de l’école et les familles depuis de nombreuses années.
Comme on l’a vu, nombre de parents et de professeurs
tiennent aux devoirs parce qu’ils croient que ceux-ci influencent positivement
les résultats scolaires. La question qu’il faut se poser maintenant
est « Ces bienfaits ont-ils été démontrés ? »
Que dit la recherche scientifique concernant
les effets des devoirs sur l’apprentissage des élèves ? La
relation entre le travail à la maison et une meilleure réussite n’a toujours
pas été clarifiée par la recherche. Cependant, la vaste majorité des études
tend à montrer que le temps consacré aux devoirs influence positivement les
résultats scolaires au secondaire[1].
Il en va
autrement au primaire. Selon la méthode d’analyse retenue, l’effet des devoirs
peut être soit :
– faible et donc négatif ;
– positif,
mais si faible qu’il n’est pas significatif sur le plan statistique[2].
Autrement dit, il est au pire contre-productif et au
mieux inefficace.
Certains chercheurs parlent même d’absence de
corrélation entre le travail personnel et les performances scolaires[3].
Ils vont à l’encontre du discours de l’Ecole primaire qui encense le travail
personnel, ce qui est une manière de se
disculper et de faire porter le poids de la réussite sur l’élève et sa famille.
Cette vision (erronée) est très fortement liée au concept de méritocratie
scolaire[4].
John Hattie[5]
a réalisé une méta-analyse qui s’est notamment penchée sur les travaux à faire
à la maison. Selon celle-ci, les devoirs n’ont qu’un impact limité sur les
résultats scolaires en primaire. Ce sont les facteurs pédagogiques et
relationnels entre élèves et enseignants qui sont les plus efficaces. Certains
chercheurs font l’hypothèse que les enfants plus jeunes ont une capacité
moindre de concentration, ou que leurs habitudes de travail sont moins efficaces,
entraînant une utilisation moins optimale du temps consacré aux devoirs.
Cependant, les devoirs à la maison peuvent être
efficaces au secondaire, mais sous certaines conditions :
− l’impact sur les résultats scolaires est plus
important pour les niveaux les plus élevés (après 15 ans). Les devoirs semblent
donc plus adaptés au niveau de l’école secondaire supérieure que primaire et
secondaire inférieur (Bonasio & Veyrunes, 2014 ; Cooper et al.,
2006). En effet, un apport positif des devoirs a pu être montré au collège pour…
les mathématiques ;
− les directives données doivent être à la
fois claires et explicites, et ne doivent pas contrevenir au rythme des élèves
;
− le type de devoirs influe sur leur
efficacité : les devoirs de pratique sont les plus fréquents, mais leur
efficacité est très limitée du fait de l’ennui qu’ils suscitent. Les devoirs de
prolongement sont plus motivants, mais leurs effets sur l’apprentissage ne sont
pas avérés. Les devoirs créatifs sont plus stimulants, mais ils risquent de
creuser les inégalités sociales[6] ;
Un devoir démocratique, c’est une activité que l’élève peut mener de façon autonome, sans être
dépendant du soutien de ses parents, qui sera à l’évidence très inégal selon
leur disponibilité physique et mentale, mais aussi leur niveau d’instruction,
leur rapport à l’école et aux savoirs scolaires[7].
Enfin, pour terminer, il vaut mieux éviter des
comportements familiaux qui imposent une multiplication des devoirs et leçons
avec la conviction que c’est là la solution à tous les problèmes[8].
A suivre… Comme enseignant, ai-je le droit de donner des devoirs ou suis-je hors-la-loi ?
[1] Cooper, Harris, Jorgianne Civey
Robinson and Erika A. Patall (2006). “Does Homework Improve Academic
Achievement? A Synthesis of Research, 1987-2003”. Review of Educational
Research, vol. 76, no. 1, p. 1-62.
[2] Cooper, Harris (2007).The
Battle over Homework: Common Ground for Administrators, Teachers and Parents.
3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: Corwin
Press, 117 p.
[3] Meuret Denis & Bonnard Claire
(2010). Travail des élèves et performance scolaire. Revue d’économie politique,
vol. 120, n° 5, p. 793-821.
[4] Brown et al.,
2010 ; Duru-Bellat, 2006.
[5] Hattie John: Visible
learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York : Routledge 2008
[6] Glasmnan et Besson, ibid. cités par Rémi Thibert dans le
Dossier de veille de l’IFÉ, Représentations et enjeux
du travail personnel de l’élève, juin 2016
[7] Philippe Perrenoud (2004). » Est-ce que tu as fait tes devoirs ? » : une question inégalement persécutante. http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2004/2004_14.html
[8] Philippe Meirieu, Ibid.

Sep 8, 2019 | Ecole - Education - Inclusion
On a vu que les familles n’étaient pas égales face
aux devoirs. Selon qu’il soit né de parents qui ont fait de longues études ou
non, un enfant bénéficie d’aide aux devoirs ou non. Dès lors, il est important
que chaque professeur ait son attention attirée sur la nécessité d’éviter que
la scolarité ne pénalise les enfants en fonction de leur environnement familial.
Si les familles ne sont pas égales face aux
devoirs, il en va de même pour les professeurs. Selon qu’ils soient formés ou
non à la pédagogie, la multiplication de leurs exigences se révèlera ou non
inflationniste. Avec le risque de pénaliser les élèves jusqu’à provoquer des
rejets scolaires et/ou à décourager et les démobiliser par des excès de travaux
à domicile.
En continuant d’affirmer que le travail assure une réussite scolaire, l’Ecole légitimise sa propre incompétence et induit chez les élèves une course à la réussite et la croyance qu’à « travail égal, note égale »[1]. C’est évidemment faux, car nul n’est égal face aux apprentissages. Cette course à la réussite fait de nos enfants des compétiteurs prêts à sacrifier les autres – leurs pairs – sur l’autel de la réussite scolaire, du moment qu’eux aux moins passent à travers les mailles du filet. En ce sens, les professeurs qui donnent des devoirs ne forment pas leurs élèves à la citoyenneté. Tout au contraire !
Les devoirs vont à l’encontre des rythmes
biologiques de l’enfant. Il est absurde de laisser des enfants assis 6 à 8
heures par jour derrière une table, puis de les obliger à se remettre aux
apprentissages une fois rentrés à la maison pour étudier une leçon ou faire un
devoir. La journée est trop lourde.
Une étude Pisa a établi que, dans les pays de l’OCDE, en moyenne, un élève de 15 ans consacre 5 heures par semaine à faire des devoirs. L’Espagnol, en bas du classement, y passe 7 heures. Le Belge frôle les 6 heures. Finlande et Corée : 3 heures. Portant sur l’année 2012, publiée en 2014, cette étude a noté que, globalement, le temps consacré aux devoirs était en recul par rapport à une étude menée en 2002. Mais pour l’OCDE, ce temps reste « considérable ». Bref : excessif[2].
Les devoirs vont à l’encontre des rythmes
scolaires. L’année scolaire, en Belgique, compte 182 jours ouvrables chaque
année. Sur ces 37 semaines, deux aux moins sont perdues à Noël, puis en juin
pour faire des révisions, des examens et pour occuper les élèves en attendant
les vacances. Cela représente au moins 20 jours perdus sur l’année pour les
apprentissages. Perdus, parce que les examens ne servent pas à évaluer mais à
sélectionner les élèves au cours d’une compétition qui n’a rien de pédagogique.
C’est tout le contraire d’enseigner : l’évaluation ne doit pas être
sommative mais formative[3].
Le fait d’évaluer formativement, au quotidien, permettrait de gagner 4 à 5
semaines par an pour les apprentissages, pour les remédiations et donc aussi…
pour faire les devoirs en classe. Dans une école où les professeurs courent
constamment après le temps, il est étonnant qu’ils aiment tant en perdre.
Les devoirs ne respectent pas les droits de l’Enfant. Notamment, ils l’empêchent de bénéficier des droits reconnus dans l’article 31 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant. Celui-ci reconnaît à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique[4]. Il n’est pas normal que des élèves de primaire ou de secondaire soient obligés d’abandonner des activités sportives ou culturelles pour consacrer leur soirée, leur mercredi après-midi, ou leurs WE au travail scolaire. Outre le fait que cela nuise à leur repos, les devoirs empêchent d’autres apprentissages non scolaires, mais au moins tout aussi importants : pouvoir faire du sport, de la musique, d’accéder à l’art et de se cultiver dans d’autres registres que ceux imposés par l’école.
Les devoirs affectent également la santé de
l’enfant. Non seulement, ils le privent d’un juste repos et d’une détente bien
méritée, mais les devoirs pèsent physiquement lourds sur le dos de l’enfant. La
charge moyenne d’un cartable est de 6,4 kg par enfant, ce qui représente entre
27 et 36 % de son poids, alors qu’il ne devrait pas dépasser les 10 %[5].
Enfin, d’autres droits de base sont mis à mal par les devoirs, notamment le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique[6]. Quel temps lui reste-t-il pour cela, une fois ses nombreux devoirs terminés ? Quantité d’enfants ne peuvent pas faire de scoutisme, s’inscrire dans un club sportif ou bénéficier des plaines de jeux, de par la charge du travail pour l’école, externalisé vers la famille.
A suivre… Des bénéfices pas toujours démontrés
[1] Barrère A., 1997, Les lycéens au travail, Puf
[2] LE SOIR 16 novembre 2016 – Pierre
Bouillon « La Ligue des
droits de l’enfant part en guerre contre les devoirs excessifs ».
[3] Article 15 du Décret Missions – 1997
[4] CIDE – ONU 1989
[5] Dominique Glasman, Leslie Besson. Le travail
des élèves pour l’école en dehors de l’école, Rapport établi à la demande du Haut
conseil de l’évaluation de l’école, 2004
[6] Article 15 de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant