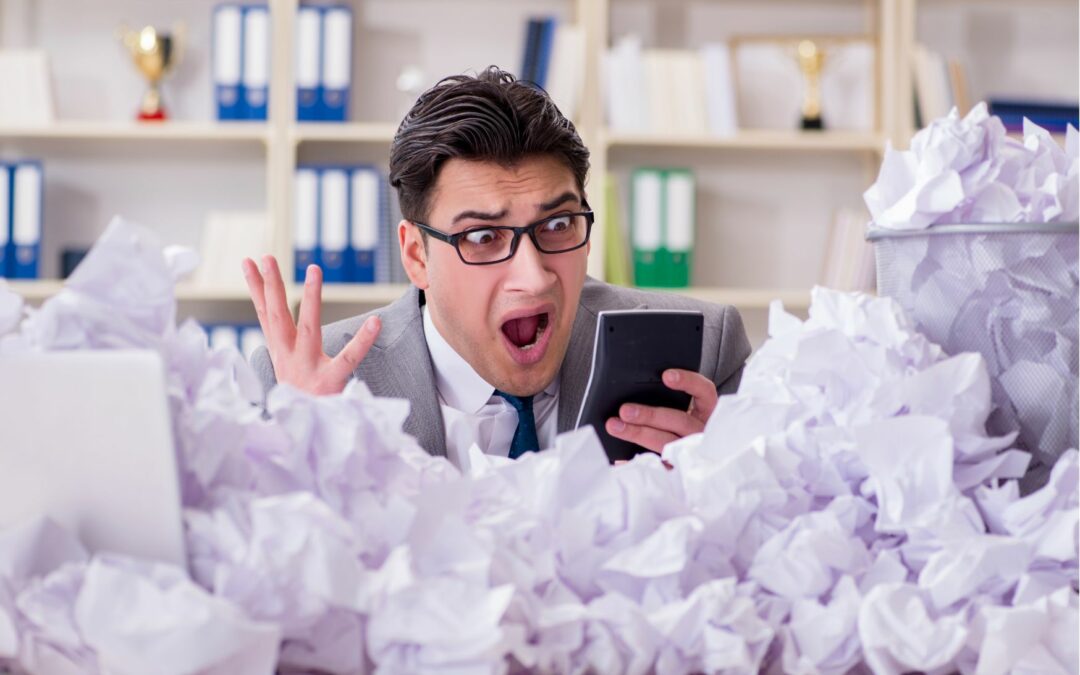Comment font les pédagogies actives, qui ne mettent pas de points ?
De nombreuses écoles n’utilisent pas les notes.
Des enseignants-citoyens, au sein de leur classe, et des écoles-citoyennes ont arrêté les notes depuis parfois des années. Les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Il faut y aller progressivement, sauf si c’est un choix d’équipe pédagogique très volontariste, mais même dans ce cas, réflexion vaut mieux que précipitation.
L’important est de permettre à tous les élèves de s’inscrire dans leurs apprentissages afin d’y trouver du sens et surtout du plaisir. La compétition est un mauvais choix, il faut donc les former à la coopération. La pédagogie du même nom est validée depuis des décennies, initialement dans les pays anglo-saxons, mais elle trouve de plus en plus sa place dans nos systèmes éducatifs. Pour changer l’école, il est impératif de changer de méthode d’enseignement et de faire de la pédagogie[1].
En pédagogie coopérative, on utilise généralement un système d’évaluation simple : Parfaitement acquis (vert), correctement acquis (orange), en voie d’acquisition (rouge). Les deux premiers degrés pouvant être fusionnés. Une fois qu’un savoir est acquis, peu importe si c’est avec brio ou si cela été acquis en suant toutes les gouttes de son corps. L’important étant le fait que l’apprentissage soit intégré, point !
Evaluer prend du temps. Ce n’est pas souligner quelques fautes et inscrire une note peu réfléchie à la va-vite. Evaluer c’est chercher à comprendre le cheminement de chaque élève, voir où il « accroche » afin de lui expliquer comment éviter les écueils et progresser. C’est aussi réfléchir à la remédiation immédiate que l’on va mettre en place avec lui, avec son aide et celle des autres, dans un tutorat qui fera progresser tout le monde : tutoré et tuteur.
Evaluer c’est aussi faire des bulletins autrement. Des bulletins sans points, mais qui reprennent l’état des lieux : chaque apprentissage avec son évaluation, le tout, accompagné de commentaires les plus pointus possibles. Chaque élève est évalué dans chacune des disciplines. Un instituteur rédigera entre 8 et 20 lignes pour chaque banche. Un professeur en fera autant pour chaque élève dans la ou les disciplines qu’il enseigne. Par exemple, un instituteur évaluera le comportement dans les apprentissages, les apprentissages en mathématique, en français, en éveil, dans les apprentissages coopératifs et au niveau du développement personnel. Il laissera les cours philosophiques, la seconde langue et l’éducation physique aux professeurs spécialisés. A raison de 5 à 15 lignes par discipline, il rédigera, entre 1500 et 2000 lignes pour ses 25 élèves, lors des « grands » bulletins. Moitié moins pour les bulletins intermédiaires. Cela représente une cinquantaine de pages, soit 2 par élève.
Mais c’est important. Mieux que les points, ces évaluations permettront aux élèves (et à leurs parents) de savoir où ils en sont par rapport à chaque apprentissage et ce qu’il y a lieu de mettre en place en termes de remédiation immédiate (en classe), par la suite. Dans ce système d’évaluation, il n’y a plus de « mauvais » élèves. Par définition, tout le monde est « bon », mais tout le monde n’a pas nécessairement facile à apprendre. Ensemble, et avec l’aide de tous, « on » va y arriver.
Concernant les diverses approches pédagogiques, il est difficile d’être exhaustif, tant les évaluations se font de manières différentes selon les écoles, même parmi celles adhérant à un même courant pédagogique. Voici quelques exemples de ce qui se fait dans certaines de ces écoles :
- Pédagogie Freinet
Dans les écoles à pédagogie Freinet, l’objectif n’est pas la performance de l’élève mais plutôt son épanouissement. Ce dernier apprend à avoir confiance en lui et à être en pleine possession de ses qualités.
Les élèves reçoivent des brevets de compétences et des ceintures de comportement. Les brevets jalonnent la scolarité de l’enfant. L’évaluation devient ainsi naturelle et s’inscrit dans un travail coopératif. En pédagogie Freinet, l’évaluation revêt trois aspects importants[2] :
- l’évaluation de l’enfant par lui-même ou autoévaluation ;
- l’évaluation de l’enfant par le groupe ;
- l’évaluation de l’enfant par le maître.
Les bulletins se terminent toujours par la rubrique « Conseils pour progresser ».
- Pédagogie Decroly
Dans les écoles Decroly, pour motiver les élèves, les professeurs comptent sur le plaisir de progresser, de comprendre, de faire soi-même, d’être dans « l’élan ». « On travaille pour avoir de bonnes appréciations, pour ne pas être à la ramasse ». Et s’il n’y a pas cet « élan » ? Qu’à cela ne tienne, les adultes patientent. « Tu as décidé de ne rien faire, c’est ton problème, mais ne distrais pas les autres ».
Les mots remplacent les notes. Ils sont bienveillants, par principe. L’école Decroly pratique depuis 60 ans une forme d’évaluation par compétences. Les appréciations des professeurs sur les bulletins sont de vrais romans feuilletons[3].
- Pédagogie Montessori
Dans les écoles Montessori, l’évaluation a lieu au fur et à mesure du déroulement des ateliers. L’enseignant prend le temps d’observer chacun de manière individuelle …la régularité sur l’année de ces ateliers permet aux élèves de prendre le temps de faire leurs apprentissages et aux enseignants de se poser pour observer chacun d’eux.
Dans les petites classes, l’évaluation est davantage gérée par l’adulte même s’il invite progressivement l’enfant à identifier et verbaliser les critères de réussite et à avoir ainsi un regard sur ses apprentissages. Le cahier de réussite permet à l’enfant de prendre conscience de ses apprentissages.
En moyenne section, l’élève est de plus en plus associé à l’évaluation grâce aux tableaux d’autoévaluation ; en fin d’année il évalue « seul » ses compétences concernant les ateliers Montessori.
En grande section, l’élève s’autoévalue, il perçoit les étapes successives à dépasser pour atteindre un objectif final. Il se met en projet.
Le cahier
individuel de suivi permet au maître de suivre les activités menées par l’élève
qui coche les activités qu’il réalise. Il permet à l’élève de se repérer.
[1] A contrario de ce qui se fait « traditionnellement » dans nos écoles, c’est-à-dire de l’A-pédagogie (avec alpha privatif) : de l’enseignement frontal, de la compétition et de la sélection. Bref, du cassage d’élèves.
[2] Pour l’évaluation en pédagogie Freinet, lire le Nouvel Educateur n° 189 – Evaluer, s’évaluer en pédagogie Freinet consultable sur https://www.icem-pedagogie-freinet.org/le-nouvel-educateur-189
[3] https://www.nouvelobs.com/education/20141210.OBS7432/decroly-l-ecole-qui-a-renonce-aux-notes-il-y-a-60-ans.html