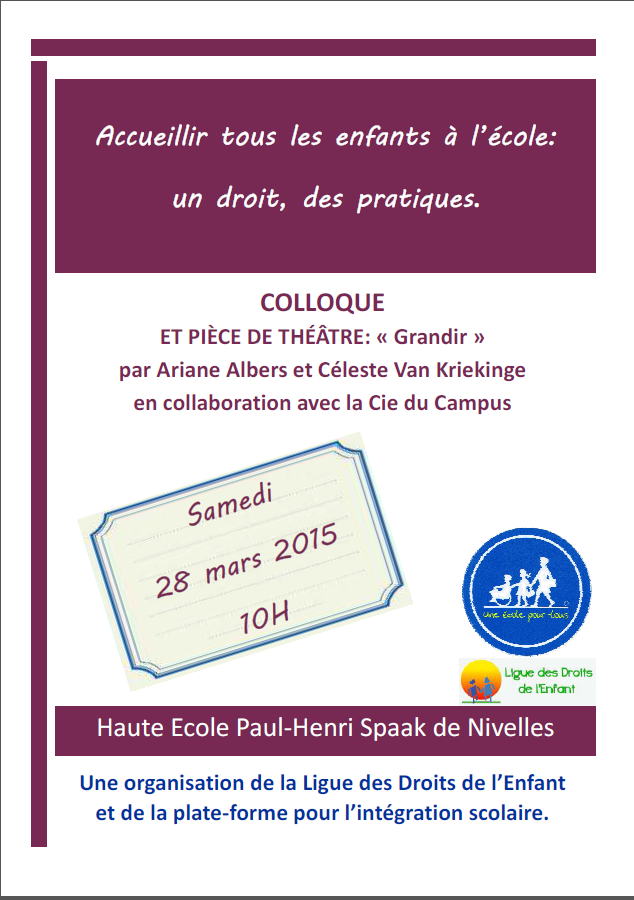Oct 2, 2016 | Ecole - Education - Inclusion
Quelles écoles sont concernées par l’intégration
scolaire ?
L’intégration
scolaire concerne les écoles dites « ordinaires » (l’école du
quartier ou toute école d’enseignement « ordinaire ») et les écoles
de l’enseignement spécialisé.
Qu’est-ce que l’intégration scolaire ?
L’intégration
scolaire concerne tous les élèves
à besoins spécifiques qu’ils soient dans l’enseignement ordinaire ou dans
l’enseignement spécialisé.
L’intégration
scolaire permet à tout enfant à besoins spécifiques de poursuivre son cursus scolaire dans
l’école de son choix – généralement une école d’enseignement ordinaire – avec
le soutien de l’enseignement spécialisé, sans nécessairement y être
physiquement (en tout ou en partie – voir ci-après).
Concrètement,
l’élève est généralement intégré dans une classe ordinaire (en tout ou en
partie – voir ci-après) où il bénéficie d’un certain nombre d’heures
d’accompagnement. Celui-ci est assuré par un-e enseignant-e provenant de
l’enseignement spécialisé et qui, donc, doit avoir les compétences spécifiques
pour accompagner l’enfant en fonction de son handicap.
Qu’entend-on par handicap ?
« La
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées,
ratifiée par la Belgique, définit les personnes handicapées comme étant « des personnes qui présentent des incapacités
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».
La
législation anti-discrimination ne propose pas de définition du handicap,
l’objectif étant d’appliquer une conception large du handicap, qui inclut les
maladies chroniques, ainsi que les troubles de l’apprentissage, de l’attention
et du comportement. Il n’est pas nécessaire d’être reconnu par une instance
officielle comme l’INAMI, le SPF Sécurité sociale ou les fonds régionaux
(AWIPH, Phare, VAPH, DPB).
En effet, dans l’esprit de la législation anti-discrimination et de la Convention ONU, le handicap naît de la confrontation entre une déficience qui entraîne, dans certaines situations, des incapacités et un environnement inadapté. Il s’agit bien d’une approche davantage sociale que médicale. L’environnement est questionné et plus seulement la différence spécifique de l’individu. On parle donc de « situation de handicap ». Une même personne peut être en situation de handicap dans un contexte donné et pas dans un autre. » (A l’école de ton choix avec un handicap – Centre interfédéral pour l’Égalité des Chances – www ……)
Combien il y
a-t-il de types d’intégration possible ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il y a quatre types
d’intégrations possibles. Dans TOUS les cas, l’élève doit être inscrit
administrativement dans l’enseignement spécialisé et, même s’il suit tous les
cours dans l’enseignement « ordinaire » et l’élève bénéficie (en
Région wallonne) de la gratuité des transports scolaires.
- L’intégration permanente totale
Cette forme d’intégration – la plus recherchée pour les enfants orientés
abusivement vers le type 8 (voir ?????) – permet à l’élève de suivre TOUS
les cours pendant TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE dans une école
« ordinaire » (en général « son » école si elle l’accepte).
Il bénéficie donc d’un accompagnement assuré par l’enseignement spécialisé à
raison de 4 heures par semaine (8 heures au 3e degré du secondaire).
Attention : Il faut que la demande soit acceptée et
que l’élève soit inscrit dans l’enseignement spécialisé au plus tard le 15
janvier !!!!
- L’intégration permanente partielle
L’élève suit certains cours dans l’enseignement « ordinaire » et d’autres dans l’enseignement spécialisé et ce, durant TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE.
- L’intégration temporaire totale
L’élève suit la totalité des cours dans l’enseignement « ordinaire » pendant UNE, voire DES PÉRIODES DÉTERMINÉES DE L’ANNÉE. Il n’est pas nécessaire de suivre des cours dans l’enseignement spécialisé.
- L’intégration temporaire partielle
L’élève ne suit qu’une partie des cours dans l’enseignement « ordinaire » pendant UNE, voire DES PÉRIODES DÉTERMINÉES DE L’ANNÉE. Il lui est possible de suivre d’autres cours dans l’école spécialisée dans laquelle il est inscrit.
Si
vous avez compris cela, vous n’êtes pas au bout du chemin… ce n’était qu’une
mise en bouche. Si vous n’avez pas encore mis votre ceinture, c’est le moment,
nous allons accélérer…
Qui peut demander une intégration scolaire ?
- Si l’enfant est dans un enseignement
spécialisé et demande une (ré)intégration, la demande doit émaner soit :
- du Conseil de classe de l’établissement d’enseignement spécialisé.
Ledit Conseil de classe est composé de l’ensemble des enseignants, du personne paramédical
et des auxiliaires d’éducation qui encadrement
directement l’élève ;
- du CPMS qui assure la guidance des élèves de l’école spécialisée ;
- des parents ou, comme le veut la loi, des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève s’il est
majeur;
- Si l’enfant
à besoins spécifiques est dans un enseignement « ordinaire » et
demande une aide à l’intégration, soit :
- des parents ou, comme le veut la loi, des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève s’il est
majeur;
- de l’équipe éducative avec avis favorable du conseil de participation
dont chaque composante a marqué un accord ;
- du CPMS qui assure la guidance des élèves au sein de
l’établissement d’enseignement ordinaire.
Attention :
Depuis 1997, le projet
d’établissement de toutes les écoles d’enseignement « ordinaire »
doit contenir les éléments favorisant la faisabilité de ladite intégration
La demande d’intégration scolaire doit être
introduite par la direction de l’enseignement « ordinaire » auprès de
a direction de l’école spécialisée qui doit concerter tous les intervenants repris
ci-dessus.
- Si la concertation débouche sur un avis DÉFAVORABLE les partenaires devront motiver leur désaccord par écrit et le communiquer au chef d’établissement ou au PO de l’école d’enseignement « ordinaire ».
- Si la réponse est FAVORABLE, la proposition est signés par les différents intervenants et introduite auprès du chef d’établissement d’enseignement spécialisé. Celle-ci concerte tous les intervenants qui doivent donner un avis favorable. Dès l’acceptation de la proposition d’intégration, la définition d’un projet d’intégration adapté aux besoins de l’élève est recherchée conjointement par : 1° le conseil de classe de l’établissement d’enseignement spécialisé 2° le conseil de classe de l’établissement d’enseignement ordinaire concerné, assisté par le centre psycho-médico-social qui assure la guidance des élèves de l’établissement. A ce stade, un protocole est établi.
Le projet d’intégration, wadesda ?
« Le projet
d’intégration est défini conjointement par les deux équipes éducatives,
assistées par l’organisme ou le centre qui assure la guidance de l’élève.
L’organisme ou le centre PMS de l’enseignement ordinaire est associé à cette
procédure.
L’intégration
est chaque fois un projet unique,
qu’il soit individuel ou collectif, qui doit:
- être guidé par l’éthique, la
déontologie et la responsabilisation de tous les acteurs;
- répondre, de manière personnalisée, aux besoins éducatifs
spécifiques de chacun des enfants intégrés dans un milieu de vie scolaire
ordinaire;
- se fonder sur des arguments
pédagogiques;
- étudier objectivement la faisabilité du projet;
- proposer la mise en oeuvre d’un dispositif dynamique.
Protocole d’intégration
À l’issue de la procédure, un protocole est établi. Il
contient:
- le projet
d’intégration (la synthèse du dossier de l’élève, les objectifs visés,
l’équipement spécifique, les besoins de l’élève en matière de transport et les
dispenses éventuelles au programme de l’enseignement ordinaire, le dispositif
de liaison entre les deux écoles);
- les modalités d’accompagnement et le choix du
personnel ;
- les modalités de
concertation et les modalités d’évaluation interne de l’intégration;
- l’accord des deux
centres PMS;
- l’accord des deux
directions;
- l’accord des parents,
de la personne responsable ou du jeune s’il est majeur. »
(Vademecum de l’intégration www.enseignement.be)
Quand on vous
dit que tout cela est compliqué… Ce système n’est pas fait pour les enfants
mais pour gérer administrativement une relation entre deux types d’écoles qui
n’avaient pas l’habitude de fonctionner ensemble. Loin de nous l’idée de dire
qu’il ne faut pas de règles, mais il est inacceptable que l’intégration
scolaire soit un parcours du combattant. Elle doit, pour les familles, être un
long fleuve tranquille, point à la ligne !!!
Le Décret de
2009 entrouvre une porte qui n’existait pas auparavant. Mais il ne fait que
l’entrouvrir ! En 2015, 2000 enfants ont été intégrés. Une bonne part
n’étant que la régularisation d’intégrations « sauvages » – nous
préférons dire « pirates » – sans aides spécifiques. Quant au reste,
se sont principalement des enfants socialement précarisés ou avec des « dys »,
qui en bénéficient. Très peu d’enfants handicapés mentaux. Pour ainsi dire pas d’enfants avec troubles
du comportement. Il y a une véritable discrimination dans l’intégration
scolaire !!!
Il y a 34 000
enfants dans l’enseignement spécialisé, dont très, très peu ne peuvent pas être
intégrés. Plus de 90 % devraient se trouver dans des écoles
« ordinaires » avec une scolarité adaptée, au sein de leurs pairs. Il
faut donc arrêter de d’alimenter le spécialisé afin de pouvoir rediriger les
moyens libérés vers l’intégration scolaire.
Mais le pire
de l’indignité réside dans le fait que toute intégration dépend du bon vouloir
des différents intervenants. C‘est le « fait du prince », avalisé par
une Communauté française complice : un-e professeur-e, un-e directeur/trice revêche, peu soucieux-se
du bien des enfants, porteur-porteuse de valeurs élitistes de méritocratie,
organisant la compétition des élèves au sein de son propre établissement et par
là même la sélection « naturelle » des élèves en difficultés, ne va –
bien évidemment – pas accepter d’intégrer un enfant ayant des besoins
spécifiques. Tout simplement un enfant, avec tout ce que cela importe de
fragilités, de besoins de protections, d’aides pour grandir à son rythme, de
patience et de compréhension. Malheureusement, rien n’est encore en place pour
éjecter ces êtres nuisibles de ce lieu fait pour aider les enfants à grandir,
pour en faire des citoyens réflexifs, dotés d’intelligence et d’empathie envers
les autres, armés pour construire un monde plus juste. Ils le pervertissent par
leur suffisance et leurs certitudes d’un autre âge qui n’a plus sa place dans
une Ecole du XXI siècle. Les enfants ont droit à une TOUT AUTRE ECOLE où ces
gens n’auront plus leur place. Une école faite pour les enfants. TOUS les
enfants !!!

Avr 19, 2016 | Ecole - Education - Inclusion
Communiqué de presse
Une nouvelle ministre pour finaliser le Pacte ou pour le torpiller ?
Si nous nous réjouissons que le navire de l’école ne soit plus sans capitaine, nous sommes interpellés par un casting qui réveille en nous une certaine inquiétude, si pas une inquiétude certaine.
Notre système scolaire est singulièrement inéquitable et discriminant. La ministre Schyns a aujourd’hui la mission de reprendre les travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence. Rappelons que ce « Pacte » est la réponse du monde Politique à l’ « Appel à refondation » lancé par le monde associatif, le 31 janvier 2014. Or, à l’époque, madame Schyns a clairement exprimée son désaccord avec cet Appel[1].
Nous craignons qu’au moment ou le Pacte arrive à un tournant, les avancées qu’il aura engrangées ne soient torpillées et vidées de leurs effets positifs. Par exemple et pour ne pas le nommer, citons le tronc commun polytechnique jusque 16 ans qu’une majorité d’acteurs revendique : dès sa prise de fonction, la ministre le limite à la fin de la troisième année secondaire, qu’elle veut « orientante[2] ».
Cette déclaration nous fait craindre le pire. Madame Schyns tient-elle à une école à deux vitesses, inégalitaire et discriminante ou, plus simplement, relaie-t-elle déjà les positions d’un certain réseau ?
Notre priorité : une école qui refuse les inégalités scolaires.
Rappelons que nous voulons une école qui permette à chacun.e de devenir citoyen, càd qui permette d’acquérir les savoirs et les connaissances nécessaires pour appréhender le monde et participer activement à sa transformation vers plus de justice. Ce droit à l’éducation doit se faire sur base de l’égalité des chances, donc… en ne laissant personne en chemin et en n’orientant pas précocement[3].
Nous invitons donc la ministre Marie-Martine Schyns, à relire l’ « Appel à refondation » dont la plate-forme de lutte contre l’échec scolaire était à l’initiative. La Ligue sera attentive aux prochains arbitrages gouvernementaux, suite aux travaux du Pacte. En effet, il nous paraît utopique que le Gouvernement propose, à terme, un « Pacte » avec la société sans lever préalablement tous les tabous qui empêchent l’évolution globale du système scolaire vers l’équité, et sans solutionner ces problèmes.
[1] Le Soir du 5 février 2014. Marie-Martine Schyns: « Pas de grand soir… »
[2] RTBF : Matin première 18 avril 2016
[3] 16 ans est, pour nous, l’âge précoce minimal « tolérable » pour demander à un jeune de faire un choix de vie.

Avr 15, 2015 | Ecole - Education - Inclusion
Trop d’élèves pauvres dans le spécialisé 1 ?
L’intégration est un parcours du combattant.
Le constat que vient de réaliser l’Observatoire belge des inégalités, diffusé par LE SOIR de ce mercredi, est connu depuis quelques années. En novembre 2011, la Commission de pilotage du système éducatif avait démontré que les enfants pauvres étaient orientés 3 fois plus que les enfants nantis. Nous avions d’ailleurs dénoncé cette ségrégation avec Infor-Jeunes dans Le Soir du 30 août 2013 2 .
La Ministre Milquet veut des écoles plus intégrantes. C’est aussi notre combat et la solution que permet le Décret de 2009 3. La Convention des Droits des personnes handicapées impose d’ailleurs aux Etats Parties de créer des écoles inclusives 4. Mais nous en sommes encore loin !
L’intégration reste un parcours du combattant. Les familles ne trouvent que difficilement des écoles qui acceptent de mettre en place un projet d’intégration. Les trop rares écoles intégrantes se trouvent parfois submergées par les demandes de familles en détresse. Pendant ce temps-là, les orientations vers l’enseignement spécialisé continuent à augmenter.
Pour de nombreuses écoles, le spécialisé est LA solution à leur incapacité à répondre aux problèmes des enfants qui ont des difficultés d’apprentissage. Elles ne voient pas pourquoi elles n’orienteraient pas, « puisque le spécialisé est là pour cela ! ». Pourtant, il s’agit de discrimination 5.
Mais il n’y a pas que les écoles ordinaires qui refusent des projets d’intégration. Des écoles spécialisées mènent des combats d’arrière-garde, défendant leur pré carré. Des PMS continuent à proposer des orientations aux familles, sans proposer d’intégration. Enfin, des enseignants craignent ces élèves différents pour lesquels ils pensent n’avoir pas les outils pour les aider, alors que l’intégration les leur fournit 6.
Enfin, intégrer dans un enseignement frontal et pratiquant la sélection est un emplâtre sur une jambe de bois. Les écoles doivent changer ! L’intégration nécessite de changer ses pratiques pédagogiques afin de viser une réussite de tous les élèves (à commencer par celui qui a le plus de difficultés). L’intégration, si elle est un droit de l’enfant est aussi un bénéfice pour tous les élèves et, contrairement à ce que diront certains incompétents pédagogiques, un nivellement vers le haut, voire vers le très haut 7! A quand des écoles pour tous ?
Ce n’est pas demain mais aujourd’hui que les familles cherchent des solutions. Des écoles refusent des projets d’intégration dans la plus parfaite illégalité. Il serait temps que le politique se donne les moyens de faire respecter ses Décrets par les écoles qu’il subsidie. Et ces subsides, précisément, sont destinés à accueillir et faire réussir TOUS les enfants. Que le Gouvernement en tire les conclusions et agisse vite. Les familles en ont assez d’attendre !
1. Le Soir du 15 avril 2015, p1 et 3
2. L’enseignement spécialisé « poubelle » du général ?, Le Soir, Vendredi 30 août 2013, p. 5
Les centres PMS dirigent-ils trop vers le « spécialisé » ?, Le Soir, Vendredi 30 août 2013, p. 11
3. Le Décret Intégration scolaire du 5 février 2009 contient les dispositions relatives à l’intégration des élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire.
4. Convention des Droits de la Personne handicapée, article 24 § 2b, traitant de l’éducation « les États Parties veillent à ce que : Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire. »
5. Le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination s’applique en matière d’enseignement (fondamental, secondaire, supérieur, promotion sociale, …) et prévoit que le refus d’aménagement raisonnable est une discrimination.
6. Pour rappel, l’intégration permet l’aide d’un enseignant « spécialiste » pour conseiller et aider l’enseignant accueillant, à raison de 4 h/semaine par enfant intégré. Si trois enfants sont intégrés, cela représente 12h.
7. Colloques des 17 octobre 2014 et 28 mars 2015 de la Ligue des Droits de l’Enfant : « L’intégration, un Droit, des pratiques. »

Avr 7, 2015 | Ecole - Education - Inclusion, LGBTQI+ - Egalité de genre

Conférence / débat
Une Ecole Pour Tous doit accueillir toutes les différences. Nous parlons d’« Ecoles inclusives ». Chaque enfant, quelles que soient ses différences, doit y avoir sa place et pouvoir s’y construire dans le respect et en valorisant la richesse de ses différences.
Nous sommes encore loin de la coupe aux lèvres. L’Ecole discrimine et oriente les élèves qui n’entrent pas dans un certain schéma pré-formaté. Il est donc important, si l’on veut pouvoir accueillir toutes les différences, que les familles et jeunes concernés puissent s’exprimer sur ce qu’ils vivent et proposer des modifications de fonctionnement
La Ligue des Droits de l’Enfant interroge les usagers afin qu’ils puisent devenir acteurs de l’Ecole en général. Dans le cadre de notre Commission, nous voulons questionner l’ensemble de la Communauté LGBTQI.
Qu’est-ce qui pose problème pour cet accueil ? Quelles sont les difficultés rencontrées par les familles LGBTQI dans la non reconnaissance, voire le non respect de toutes les différences ? Qu’en est-il des jeunes qui vivent au sein de ces familles et quelles sont les difficultés encore rencontrées par les jeunes LGBTQI ? Et quel est ce principe de « Neutralité » invoqués par certains pour faire taire certains profs issus de la communauté ?
Que voulons-nous comme école réunira une série d’acteurs autour de la table et le public en matinée pour faire le point sur la situation scolaire francophone actuelle.
L’après-midi, des ateliers thématiques permettront à chacun de s’exprimer sur les sujets traités en matinée.
Programme
10 : 00 Accueil
10 : 30 – 12 : 30 Panel /Débat
Alter Vision
Le Centre Bruxellois de la Promotion de la Santé
Le Centre Interfédéral Pour l’Egalité des Chances
Les CHEFF asbl
Genres Pluriels
La Ligue des Droits de l’Enfant
12 :30 -13 :00 Lunch
13 :00 – 14 :00 Groupes de travail.
15 :00 -16 :00 Débat et mise en perspectives.
Un projet de la Ligue des Droits de l’Enfant et de la Rainbowhouse Brussels
Avec le soutien de / met de steun van huisvandeMens
Inscriptions obligatoires via ce lien

Fév 18, 2015 | Ecole - Education - Inclusion
En mai 2014, dans la perspective des élections et à l’initiative de la Plate-forme de lutte contre l’échec scolaire, des associations, syndicats et représentants de la société civile lançaient un « Appel au débat en vue d’une refondation de l’École ». Nous affirmions qu’il est plus que temps de rénover une Ecole où les disparités sont importantes et socialement déterminées. Nous identifiions les principaux freins au changement : le quasi-marché scolaire et les réseaux, la hiérarchisation des filières, les modes d’évaluation, la gestion du temps scolaire… Nous demandions par conséquent aux responsables politiques de mettre fin à la course aux réformes bâclées et d’avoir le courage d’un débat de fond, sans tabous, avec tous les acteurs, afin de proposer « un projet global, concerté et cohérent » pour l’enseignement obligatoire.
Le Pacte pour un enseignement d’excellence nous a laissé espérer que nous avions été entendus. Pourtant nous sommes inquiets pour plusieurs raisons.
Pour commencer, la Ministre propose un débat sur des finalités de l’école qui privilégient à la fois « la révolution numérique » et « l’adéquation de l’enseignement avec le monde socio-économique ». Il nous semble qu’il s’agit là d’une conception économiste et utilitariste de l’éducation, diamétralement opposée à la vision émancipatrice et démocratique que nous revendiquons. Les objectifs que l’on décidera d’assigner à l’école détermineront les savoirs, les pratiques et les valeurs qui seront privilégiées : la connaissance et la compréhension du monde pour un citoyen critique ou la flexibilité du travailleur/consommateur ? La solidarité dans la coopération ou l’excellence dans la compétition ? Derrière le choix des mots de Madame Milquet, nous craignons qu’elle n’en ait déjà fait d’autres.
Notre deuxième sujet d’inquiétude porte sur l’idéologie « de remettre la pédagogie au centre du processus plutôt que les systèmes ». Or nous le savons – et de nombreuses études l’ont montré – l’on ne peut réduire les inégalités sans s’attaquer aux filières scolaires et à la concurrence entre écoles et donc sans l’instauration d’un véritable tronc commun pluridisciplinaire. Le cabinet Milquet sait tout cela, il l’énonce même assez clairement dans l’introduction du texte de présentation du Pacte. Et puis il lâche : « nous ne toucherons pas au système ». Voilà un singulier manque de cohérence… qui renforce notre scepticisme.
Enfin, notre troisième inquiétude porte sur le calendrier. Le Gouvernement veut des résultats dans un an ; le MR, par la voix de madame Bertiaux, leur rétorque (Le Soir, 27/1) qu’on peut prendre les mesures les plus importantes sans attendre.
Nous ne voulons plus d’un énième décret mal ficelé, d’une tantième somme de « mesurettes » sans vision. En dépit de la gravité de la situation, ou peut-être justement en raison de cette gravité, nous voulons que l’on prenne le temps d’une réflexion politiquement aboutie et scientifiquement fondée ; le temps d’un profond travail pédagogique en direction des enseignants et des parents afin d’obtenir un large accord ; le temps, enfin, d’une mise en œuvre cohérente, commençant dans l’enseignement maternel et s’étendant progressivement vers les années suivantes.
Pour ce faire, il est essentiel que tous les partis politiques s’engagent à contribuer positivement à l’effort fourni. Il serait criminel de voir toute cette énergie réduite à néant par des querelles politiciennes, confirmant ainsi l’idée selon laquelle l’école est quelque chose de beaucoup trop précieux pour le confier aux politiques.
Malgré ces craintes, nous comptons bien participer activement au débat, dans l’espoir qu’il soit encore possible d’infléchir l’orientation du Pacte vers des objectifs qui permettront réellement à l’Ecole de devenir démocratique, solidaire et humaniste. En tout cas, nous ne ménagerons pas nos efforts en ce sens.
Signataires :
Delphine Chabbert, directrice Études et action politique de la Ligue des familles
Pascal CHARDOME, Président de la CGSP Enseignement
Jean-Pierre Coenen, Président de la Ligue des Droits de l’Enfant
Bernard Delvaux, chercheur au GIRSEF (UCL)
Stéphanie Demoulin, Coordinatrice de la Fédération francophone des Ecoles de Devoirs
Eugène ERNST, Secrétaire général CSC-Enseignement
Nico Hirtt, membre de l’APED
Jean-Pierre Kerckhofs, Président de l’APED
Joan LISMONT, Président communautaire SEL (SETCa)
Christine Mahy, Secrétaire générale du RWLP.
Véronique MARISSAL, Coordinatrice de la Coordination des Ecoles de Devoirs de Bruxelles
Chantale Massaer, Directrice d’Infor Jeunes Laeken.
Sylvie Pinchart, directrice de Lire et Ecrire
Luc Pirson, Président de la FAPEO
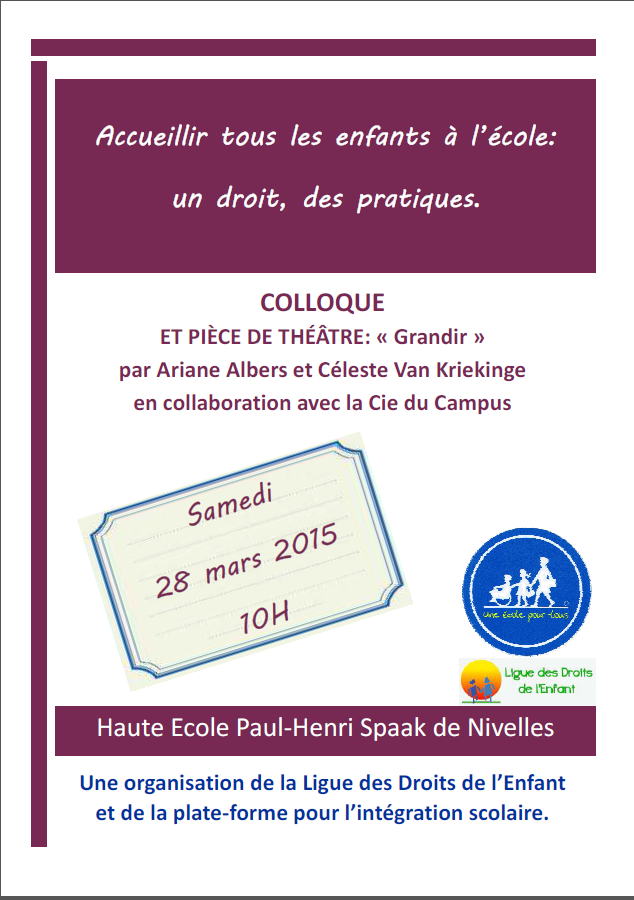
Fév 5, 2015 | Ecole - Education - Inclusion
Le vendredi 17 octobre 2014 dernier, notre association vous proposait une première partie de colloque sur le thème suivant : « Accueillir tous les enfants à l’école : un droit des pratiques ». Nous vous convions donc à assister à la seconde partie de ce colloque le samedi 28 mars 2015 prochain, à 10h à la Haute Ecole Paul-Henri Spaak de Nivelles.