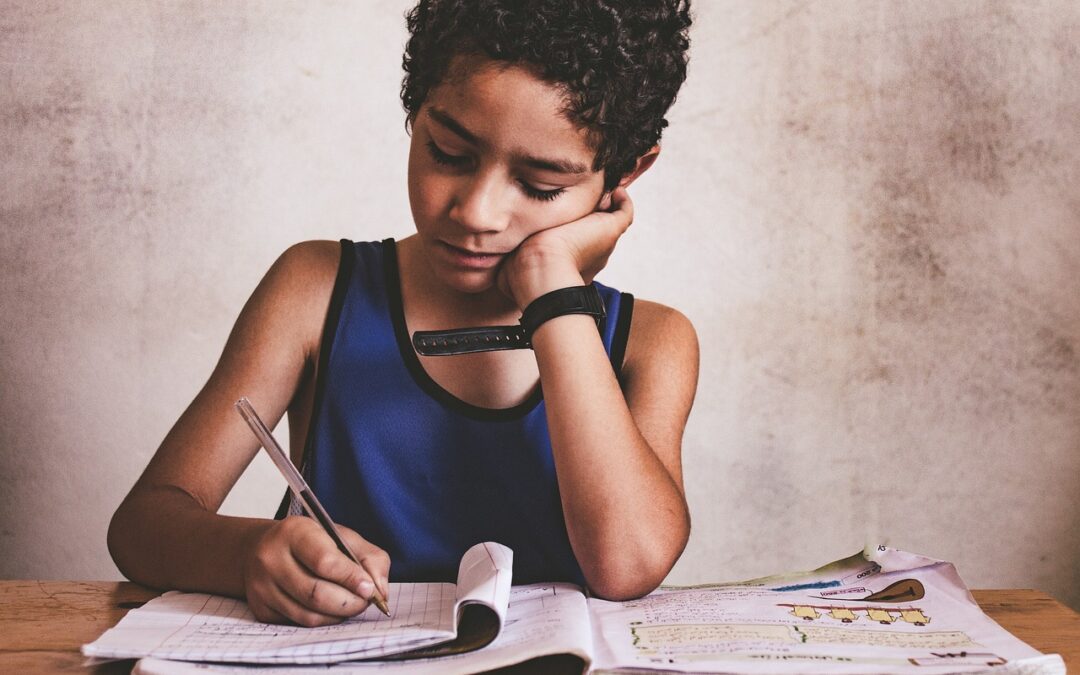1. Ecole et précarité
De nombreux jeune grandissent dans des familles multi-vulnérables : familles monoparentales, faible degré d’instruction des parents, chômage, précarité économique, difficulté de se projeter dans l’avenir, etc. La pauvreté porte atteinte aux Droits de l’Enfant dans de nombreux secteurs de la vie en société, et en premier lieu à l’école.
Les critiques portent essentiellement sur le coût de l’enseignement pour les familles, sur la stigmatisation des enfants issus de milieux précarisés et sur leur relégation vers des filières d’enseignement imposées ou non souhaitées. Cette situation méritait que nous donnions la parole à des acteurs de terrain, des associations qui connaissent bien le domaine de la précarité des jeunes et de leurs familles.
Trois associations ont accepté notre invitation à débattre sur la précarité à l’école : ATD Quart-Monde[i], l’AMO AtMOsphère[ii] et Badje[iii]. Cette analyse est le résumé de cette rencontre.
La grande pauvreté touche tous les domaines de vie. Elle empêche l’accès à l’ensemble des droits et l’exercice des responsabilités. Parmi ces droits, il y a celui de l’éducation. Malgré que l’enseignement soit obligatoire depuis 109 ans, beaucoup d’enfants pauvres sortent de l’école sans savoir lire et écrire correctement. Une grande partie des 10% d’illettrés que compte notre pays appartient aux couches les plus défavorisées de la population. Le plus douloureux dans la misère n’est pas d’être privé de tout, mais d’être méprisé, considéré comme rien, incapable, inutile.
Très souvent les gens et particulièrement les professionnels que ces personnes rencontrent « ne croient pas en elles ». Pourtant la pratique des universités populaires a démontré depuis plus de 60 ans que le dialogue, la réflexion et l’action sont possibles avec ces familles. Lors des bibliothèques de rue, on constate que ces enfants sont avides et capables d’apprendre. Tous ont des choses à nous dire sur ce qu’il faudrait mettre en place pour que l’école bénéficie réellement à tous.
2. Discriminations : une situation scolaire dramatique
Pour de nombreux enfants, l’accrochage est difficile dès la maternelle. A ce niveau, il n’est pas rare de rencontrer des orientations vers l’enseignement spécialisé, voire – encore heureux que maintenant les choses sont réglementées – des maintiens en 3e maternelle. Il n’est pas rare d’assister à des préjugés comme « Cet enfant parle comme un bébé, si cela continue, il aura des problèmes en primaire ». « Lui, il ne parle pas. Il ne fait rien (il ne sait rien faire) ». Des doutes sur leurs capacités à réussir sont émis, une scolarité difficile est « prédite » et des orientations sont proposées, souvent sans qu’un soutien spécifique ne soit mis en place dans l’école.
Ces associations constatent également une orientation massive vers l’enseignement spécialisé, sans que l’enfant ne soit porteur d’un handicap spécifique. Cela concerne 3 à 4 enfants sur 10, soit 10 fois plus que la moyenne. Cette orientation se révèle rarement porteuse d’avenir et augmente souvent la stigmatisation.
Obtenir le CEB est une grande fierté pour l’enfant et sa famille, tant le fait est rare. Le CEB est souvent le seul diplôme connu ! La plupart des jeunes décrochent dès la fin du premier cycle du secondaire. Même pour ceux qui, exceptionnellement, ont un parcours sans redoublement en primaire, le passage en secondaire constitue une période extrêmement pénible. Ils se sentent complètement largués et rejetés.
Il y a donc une expérience collective d’échec, de souffrance, de rejet et de honte de l’école, qui marque à vie, prive les personnes des moyens de prendre place dans la société et renforce l’isolement et l’exclusion. Il semble que ce traitement, tout au long du parcours scolaire, est dû principalement à un manque de connaissance, de moyens et de volonté pour répondre aux obstacles que ces enfants rencontrent au cours de leur scolarité. Il est important de revoir le mode de fonctionnement de l’ensemble de l’enseignement, dès le fondamental, pour que chaque enseignant soit capable d’accueillir tout enfant dans des conditions qui lui permettent de se développer harmonieusement et d’apprendre, afin d’atteindre pour chacun les objectifs fixés à l’enseignement.
3. Eléments d’analyse
Ces obstacles sont peu (re)connus et pris en compte par l’institution et les professionnels qui ont tendance à considérer ce qu’ils en perçoivent comme de la mauvaise volonté ou des déficiences des parents ou des enfants.
Les principaux obstacles sont d’ordre culturel. L’école s’inscrit dans une culture dominante qui, malgré les idéaux affichés de démocratie et de multi-culturalité, promeut la réussite personnelle, la compétition et la « normalité ». De nombreux préjugés demeurent sur les personnes « différentes », particulièrement sur les personnes pauvres. Dès l’entrée en maternelle les enfants vivant dans la grande pauvreté apparaissent « différent » : ils n’ont pas les mêmes acquis, le même « look » que les autres.
L’école leur apparaît comme un monde inconnu, qui peut leur faire très peur et même paraître dangereux pour eux et leur famille. Tout est différent de ce qu’ils connaissent : la langue ou le langage, le matériel, les activités, les attentes et les consignes, les rythmes… Ils ressentent aussi souvent un regard négatif porté sur eux et les leurs, parfois dès le premier contact.
Beaucoup ont rapidement l’impression que l’école, « ce n’est pas pour eux », parce qu’ils ne s’y sentent pas accueillis et n’en maîtrisent pas les codes. A cause de cette distance culturelle qui sépare leurs familles et le monde de l’école, ces enfants doivent continuellement faire des efforts inimaginables pour s’intégrer. Ils doivent les faire seuls le plus souvent, parce que l’école n’est pas consciente des difficultés qu’ils rencontrent et ne met rien de spécifique en place pour les y aider et parce que leur famille n’a aucune maîtrise de ce qui se passe dans l’école, ni de ce qu’on attend de leur enfant, ni les outils pour les y aider.
Ce monde inconnu et parfois hostile amène certains de ces enfants à développer des comportements « sains » de protection et de défense : repli sur soi, mutisme, non-participation ou, au contraire, hyper susceptibilité, agressivité, turbulence, « hyperactivité ». Ces comportements, qui pourraient dans de nombreux cas, être améliorés par un accueil personnalisé et respectueux de l’enfant et sa famille, entraînent beaucoup trop d’orientations abusives vers l’enseignement spécialisé. Les réactions des enseignants sont cruciales pour l’accrochage et la réussite scolaire tout au long du parcours scolaire. En effet, toutes ces difficultés s’accentuent et se renforcent au fur et à mesure de l’avancée dans le cursus scolaire. Elles sont exacerbées en secondaire.
Les autres difficultés sont davantage matérielles. Pouvoir se plier au rythme de l’école (ponctualité, régularité), pouvoir répondre adéquatement à ses multiples exigences et demandes (en matériel, contribution financière, travail à domicile…) est extrêmement difficile pour les familles qui vivent dans la précarité, même si elles peuvent percevoir et comprendre ces demandes et leur sens, ce qui est loin d’être toujours le cas ! Le manque d’argent est source permanente de stress que les enfants ressentent et partagent avec leur famille. Il a une influence sur le développement de l’enfant, mais aussi, au quotidien, sur ses capacités de concentration et sur son comportement.
Les familles sont continuellement dans des situations de choix impossibles : payer le loyer ou le médecin et les médicaments ; payer les frais scolaires ou manger les derniers jours du mois… La difficulté ou l’impossibilité récurrente de payer les frais scolaires « empoisonnent » tout le parcours scolaire.
4. Obstacles de toutes sortes
4.1. Les enfants
Les enfants pauvres ont peu d’amis à l’école. A cause de leur différence et de leurs difficultés, de multiples malentendus et frictions surgissent, à la fois avec les professionnels et avec les autres élèves. Beaucoup subissent des moqueries ou des remarques désobligeantes. C’est de cela qu’ils souffrent le plus et cela les empêche aussi d’apprendre, cela engendre de la honte, de la peur et de la rancœur. Favoriser la solidarité, le respect et l’amitié entre enfants est aussi une mission de l’école
4.2. Les familles
Les relations avec les familles pauvres sont généralement rares et difficiles, faites de peurs, de méfiance, de préjugés de part et d’autre, empoisonnées par les questions matérielles (d’argent, de chose à apporter…). Lorsqu’elles sont possibles et se passent bien, c’est souvent grâce à l’accueil et la disponibilité d’une personne (titulaire, directeur, médiateur… ou personnel d’entretien, de surveillance), donc dans une fragilité. Les familles ont généralement très peur de rencontrer l’école et le font alors souvent maladroitement, sur la défensive, en repli ou parfois, excédées, agressives, parce que c’est souvent une image négative de l’enfant en difficulté qui lui est renvoyée par l’école, assortie souvent d’une culpabilisation de la famille « qui ne ferait pas ce qu’il faut », alors que souvent elle n’en a ni l’information, ni les moyens. L’information passe mal parce qu’elle est souvent écrite et formulée de façon trop complexe. Les familles précarisées ont du mal à percevoir et comprendre ce qui se passe à l’école, si ce n’est le malaise de leurs enfants. Elles ne perçoivent que tardivement les difficultés et retards d’apprentissage et disposent de peu de ressources pour y faire face. Elles reçoivent peu d’informations et d’aides spontanées de l’école et des centres PMS.
Pourtant quand les familles se sentent accueillies et reconnues, quand un climat de confiance et de respect se développe entre les familles et l’école ou d’autres institutions, celles-ci sont très souvent capables de se mobiliser pour soutenir des projets qui rejoignent leurs aspirations et qu’ils perçoivent comme étant porteurs d’avenir pour leurs enfants. Ce climat se bâtit d’abord par un accueil personnel et bienveillant, tout au long de la scolarité, avec un regard positif sur les personnes et leurs capacités.
4.3. Les enseignants et les professionnels de l’école
Les enseignants connaissent peu (et n’imaginent pas) la vie de ces familles et les jugent souvent négativement, à partir de leur propre expérience et de leurs représentations : les enfants mal habillés, n’ayant pas leur matériel et parfois leurs repas, sont rapidement considérés comme « négligés » ; les parents ne payant pas les frais, ne se présentant pas aux réunions, comme se désintéressant de la scolarité, voire de leurs enfants…
La formation des professionnels (initiale et continue) à la connaissance des publics avec lesquels ils sont amenés à travailler, aux pratiques pour les rencontrer et bâtir en partenariat avec eux des stratégies communes pour réaliser leurs missions, est donc indispensable et urgente.
Une réflexion globale est à mener pour détecter les difficultés des enfants et les obstacles qu’ils rencontrent, de tous ordres, dès qu’ils se présentent et tout au long du cursus scolaire. L’enseignant doit être capable de les repérer et d’y répondre dans la mesure où ils ressortent de ses responsabilités, au sein de la classe et de l’école en priorité, notamment en maîtrisant davantage les pédagogies différentiées, la remédiation. Si les difficultés ne sont pas de son ressort, il doit pouvoir en tenir compte et, éventuellement, soutenir la famille pour qu’elle accède à des aides extérieures.
L’enseignant devrait aussi être formé à reconnaître l’éducabilité de tous et valoriser les compétences et savoirs de chacun. Ce que les enfants pauvres vivent, ce qu’ils apprennent dans leur famille est généralement peu connu et valorisé par l’école. De plus, leur « éducabilité », leurs potentialités de développement et d’apprentissages, sont peu prises en compte. Pourtant, elles se révèlent le plus souvent « normales » et même parfois étonnantes quand ils se trouvent dans des conditions favorables : climat de confiance et de respect; reconnaissance de leurs compétences et de leurs intérêts ; expérimentation du plaisir des découvertes et de la réussite ; soutien et encouragements.
Il y a une méconnaissance mutuelle entre le monde de l’école et celui de la pauvreté, qui perdure et même s’accentue. Elle est source de nombreux conflits, malentendus, humiliations. L’école s’est bâtie et se réfléchit en dehors de cette (re)connaissance ; elle n’est pas faite pour ces enfants et ces familles ; ceux-ci le ressentent rapidement. Le droit à l’éducation reste inaccessible pour la plupart des enfants vivant dans la pauvreté.
L’enseignement est-il condamné à l’inefficacité et l’impuissance à remplir ses missions pour les enfants qui en ont le plus besoin ? Les plus pauvres nous poussent chacun à aller au bout de notre idéal de démocratie, à répondre à cette question : jusqu’où sommes-nous capables de considérer un enfant ou un adulte, comme un homme, dans sa dignité et le respect de ses droits ?
5. L’école a un rôle à jouer dans la prévention des exclusions
L’école et l’enseignement peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention des exclusions et des inégalités sociales mais peut aussi les cultiver. Nous ne devons pas oublier que les enfants vivent avec leurs parents les soucis de la vie quotidienne. Argent, logement, santé… La pression qu’exerce l’école sur les parents est de plus en plus forte. Bien que la constitution prévoie la gratuité de l’enseignement, la réalité est tout autre. Les exemples de frais scolaires sont nombreux, qui viennent alourdir le budget des familles au-delà du simple achat basique de matériel scolaire : Photos de classe, tombola, cantine du midi, garderie du matin, étude du soir, piscine, voyages scolaires….
Au-delà des considérations financières, l’impact de ces frais scolaires a des conséquences importantes sur la relation triangulaire parents-enfants-école. Ainsi, certains parents préfèrent ne pas envoyer leur enfant à l’école plutôt que devoir se justifier et de dévoiler leur situation précaire. L’enfant peut également être stigmatisé par ses pairs et par l’école lorsque, par exemple, il lui est demandé d’apporter, devant toute la classe, une enveloppe qu’il n’a pas. Les reproches verbaux à l’égard d’un élève à la suite d’un non-paiement sont multiples.
L’imagination des établissements scolaires est énorme : l’école libre qui oblige les parents à être membre de l’ASBL lors de l’inscription et donc de payer une cotisation mensuelle, exclusions des internats pour non paiements des frais, refus de l’école de remettre certains documents tant que le paiement n’est pas effectué (bulletin en fin d’année, document pour la bourse d’étude, attestation de fréquentation scolaire),
Il y a aussi le cas spécifique de l’enseignement professionnel : le coût important de l’achat de matériel scolaire spécifique (exemple boucherie, coiffure). L’actualité récente a également démontré que certaines écoles demandaient aux parents d’investir dans des ordinateurs.
A côté des frais scolaires « déclarés » au sein de l’école, il ne faut pas oublier qu’une série de frais liés à la scolarité des enfants reste à charge des familles. Par exemple, les frais de transport scolaire, les frais de lunettes, les frais de logopédie ou de psychomotricité.
6. Le secteur de l’accueil extrascolaire remplit une fonction sociale, une fonction éducative et une fonction économique qui contribuent à la lutte contre la pauvreté
Outre une fonction économique qui permet aux parents d’avoir une activité professionnelle, de suivre une formation, de rechercher un emploi ou d’effectuer des démarches dans ce sens, on reconnaît à l’accueil extrascolaire deux autres fonctions essentielles :
– une fonction éducative : il joue un rôle essentiel dans l’épanouissement de l’enfant. Les notions de plaisir, de loisir et de détente y occupent une place centrale. De plus, il éveille, développe des compétences (sociabilité, évolution entre pairs…), permet des apprentissages et favorise la participation des enfants ;
– une fonction sociale : il offre un lieu de soutien à la parentalité et permet la création de lien social. Avoir accès à un milieu d’accueil de qualité représente donc un avantage pour l’enfant et sa famille et un investissement à long terme pour la société. Ces lieux de vie constituent une opportunité fondamentale pour contribuer à la réduction des inégalités.
Si de nombreux milieux d’accueil extrascolaire s’adressent à des publics précarisés, cet accès est insuffisant. Ce droit à l’accueil extrascolaire est loin d’être une réalité pour beaucoup d’enfants, notamment ceux dont la famille vit en situation de pauvreté. Les obstacles à Incessibilité sont financiers, certes, mais aussi organisationnels, géographiques et culturels.
C’est un engagement pour la promotion et la réalisation effective des droits de l’enfant, en particulier : droit à l’éducation et droit aux loisirs et repos.
[i] ATD Quart-Monde est un mouvement international. ATD va à la rencontre des personnes qui vivent dans la grande pauvreté et l’exclusion. Les actions d’ATD QM ont pour but de rendre possible l’expression de l’expérience et de l’analyse à la fois individuelle et collective des personnes vivant dans la grande pauvreté et de la faire entendre notamment aux responsables et décideurs, ainsi qu’aux professionnels des différentes institutions chargées de l’accès aux droits fondamentaux de tous et dialoguer avec eux.
[ii] AthMOspère est un service social de l’Aide à la Jeunesse « en milieu ouvert », c’est-à-dire qui travaille essentiellement en contact avec les associations. Des adultes sont présents pour donner des conseils ou un soutien dans les projets de vie des enfants. C’est aussi leur donner les moyens d’agir avant que les choses ne se gâtent. AthMOSphère, c’est aussi une association qui développe des projets. Ces projets visent à la fois à donner les moyens de construire librement une vie d’adulte et à la fois à défendre les intérêts des enfants auprès des institutions et des acteurs du système belge.
[iii] Badje est une fédération pluraliste bruxellois active dans le secteur de l’accueil des enfants et des jeunes. Les membres de Badje sont des associations et des organismes publics locaux proposant aux enfants et aux jeunes, un accueil, des animations, des activités, un soutien scolaire… et ce, tant durant l’année scolaire que pendant les périodes de vacances. LA plupart de ces associations accueillent un public principalement issu de milieux défavorisés et de l’immigration.
Badje allie l’action sur le terrain et la promotion d’une politique cohérente de l’accueil, centrée sur les besoins de l’enfant et valorisant les enjeux éducatifs et sociaux des politiques d’accueil. L’accessibilité des milieux d’accueil aux enfants les plus vulnérables constitue une préoccupation transversale et permanente de l’association.